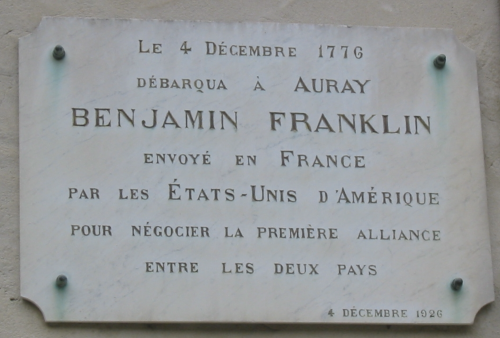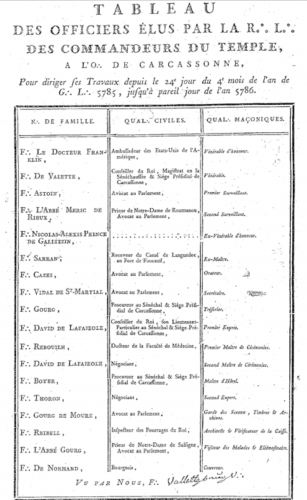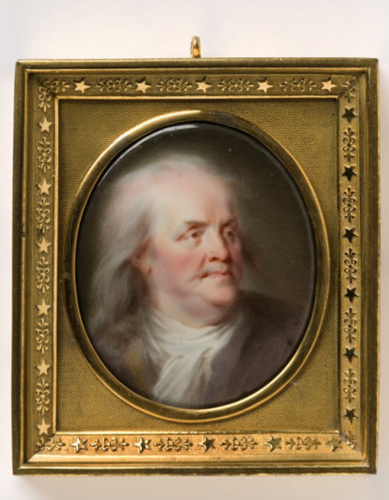Morgane Larroux remet l'écharpe de maire à G. Larrat, vendredi 3 juillet 2020
Les élections municipales de 2020 ont mis en évidence dans le programme des listes progressistes, le désir de mener une politique tournée vers la citoyenneté participative. Autrement dit, la promesse d’associer la population aux décisions engageant la responsabilité de la commune. Dans les faits, plusieurs municipalités et depuis longtemps déjà organisent des réunions au sein de comités de quartiers ; ce phénomène existe et n’est pas nouveau. Disons que l’actualité des derniers mois en a peut-être fait un argument de vente électorale qui, dans certains cas, a su attirer les électeurs. La démocratie s’exprime par la représentativité du peuple au sein d’une assemblée élue prenant des décisions en son nom. Avant la Cinquième République, les assemblées étaient élues à la proportionnelle, aucune majorité ne se dégageait et l’on était contraint de trouver des alliances pour gouverner. Lorsque ces alliances de circonstances ayant donné lieu à des marchandages de boutiquiers tombaient, le Président du conseil des ministres démissionnait.
Au conseil municipal de Carcassonne et jusqu’en années 1960, le maire radical-socialiste fut obligé de composer avec la S.F.I.O et le M.R.P pour s’assurer une majorité. Entre 1947 et 1953, l’assemblée municipale fut dissoute par deux fois à cause de dissensions sur le budget. Le 26 avril 1953, le scrutin donna 9 sièges au Parti communiste, sept à la S.F.I.O, 9 aux Radicaux-socialistes et 4 au M.R.P. Lors de l’installation du conseil municipal le 11 mai, c’est Jules Fil qui devint maire avec l’apport des voix du M.R.P et du P.C. Ces mêmes chrétiens-démocrates qui jusque-là gouvernaient avec les radicaux. Après avoir entonné l’Internationale dans la salle du conseil, on chanta l’Ave Maria et Jules Fil sortit conspué par la foule. La S.F.I.O réussit ainsi le coup de Jarnac en s’installant aux commandes de la ville sans en avoir reçu totalement le mandat du peuple. Lors du scrutin de 1959, Jules Fil monta sa liste « L’Union des gauches » avec les communistes et parvint à se faire élire sans le M.R.P, ni des radicaux réduits à la portion congrue. Les socialistes s’installèrent à la tête de la commune jusqu’en 1983. Ils gouvernèrent jusqu’en 1983 avec le Parti communiste sans aucune opposition municipale. En effet, la loi électorale qui avait changé, assura à toute liste victorieuse la totalité des sièges au conseil municipal. Nous étions donc passé d’une assemblée ingouvernable sous la IVe République, à une assemblée incontrôlable sous la Ve.
Carcassonne fut ainsi gérée pendant vingt-quatre années par un exécutif vantant la concertation démocratique de la population, mais qui dans un même temps ne permit pas à l’opposition de contrôler son action, ni de s’exprimer. Ce pouvoir tout puissant se retrouvait même au sein des comités de quartier, dans lesquels on retrouvait majoritairement des sympathisants du parti dominant. N’oublions pas qu’il détenait également le département de l’Aude.
Il faudra attendre l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 pour voir enfin la loi électorale évoluer vers davantage de représentativité dans les conseils municipaux. C’est tout le paradoxe pour Carcassonne, puisque la ville basculera à droite en mars 1983. Le 13 juillet 1982, un nouveau mode scrutin, toujours en vigueur pour les élections municipales, changea totalement l’attribution des sièges pour les villes de plus de 30 000 habitants. Le texte stipule que cette réforme permettra de dégager une majorité réelle, conditions indispensable à la gestion de la commune. Les conseillers municipaux seront désormais élus au scrutin de liste à deux tours.
Au premier tour comme au second tour, la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés obtiendra la moitié des sièges au conseil municipal. Le reste sera réparti suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant réuni au moins 5% des suffrages exprimés.
Loin de l’anarchie de la proportionnelle intégrale, ce système permet d’assurer la représentativité et la diversité des opinions tout en conservant une majorité pour gérer les affaires communales. L’opposition participe à des commissions, contrôle l’exécutif et s’exprime dans les bulletins municipaux.
_____________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020