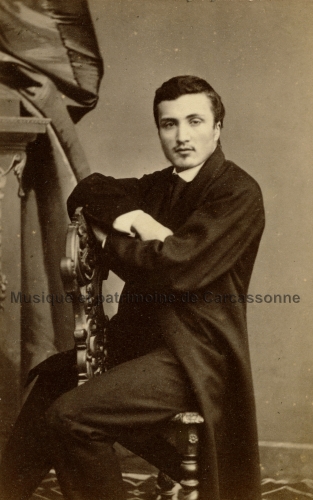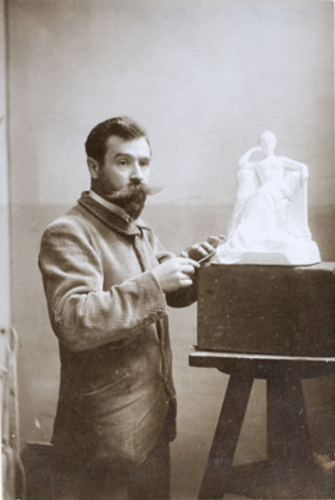Cécile Farges est née à Carcassonne le 25 mai 1922. Son père, Jean-Pierre, était natif de Molières sur l’Alberte (près de Ladern) dont son propre père fut le Maire. Sa mère née en Lorraine avait connu son mari à la fin de la guerre et l’avait suivi ensuite dans l’Aude. Combattant de la guerre de 14, blessé à plusieurs reprises, son père était titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre avec citation à l’ordre de l’armée. Il fut le porte-drapeau infatigable de l’association des médaillés militaires de Carcassonne jusqu’à sa mort.

Cécile Fourès, née Farges
Elle a vécu sa petite enfance à Pomas puis à Carcassonne où elle a fréquenté le collège André Chénier puis l’école Pigier. Son premier employeur, a été Maître Nogué, avoué à Carcassonne et neveu de Maurice Sarraut, sénateur audois, assassiné par la milice en 1943 à Toulouse. Elle resta à son service de 1939 à 1943. De 1943 à 1945 elle est employée par la Chambre des métiers de l’Aude où elle est excellemment notée. A une exception prés : chargée par la hiérarchie Vichyste de dresser la liste des jeunes artisans Carcassonnais en âge d’être réquisitionnés pour partir en Allemagne au titre du Service du Travail Obligatoire (STO) elle avait une fâcheuse tendance à oublier des noms ou à sauter des lignes. Convoquée à la Préfecture par un fonctionnaire collaborationniste elle s’en tira en jouant les écervelées. A la Libération ce fonctionnaire zélé n’en continua pas moins sa retraite paisiblement.
En 1945, elle intègre la société Méridionale de Transport de Force qui après la nationalisation devint Electricité de France où elle gravit de nombreux échelons jusqu’à devenir agent de maîtrise. C’est à EDF que se terminera sa carrière professionnelle en 1980 comme chef de groupe. Les nombreux témoignages desatisfaction dont elle fait l’objet attestent de la qualité de son travail, de son sérieux et sa compétence.
Comme nous le savons tous, c’est en novembre 1942, après le débarquement américain en Algérie, que les allemands, ayant franchit la ligne de démarcation occupèrent le sud de la France et firent leur apparition dans notre ville où ils s’installèrent. Elevée dans le souvenir de la grande guerre, Cécile Fourès ne put se résoudre à la passivité. Ayant rencontré, au mois d’août 1942, Charles Fourès qui venait de s’évader d’Allemagne elle résolut de résister à l’ennemi. Comme son jeune ami était mû par les mêmes convictions leur destin allait s’en trouver lié.
Charles Fourès, sergent de l’infanterie alpine, mobilisé en 1939 avait été fait prisonnier dans la Somme et détenu à Cologne. Ne pouvant se résoudre à accepter sa captivité, il conçut rapidement un plan d’évasion et avec un camarade originaire de la région, Raymond Boquet, le mit à exécution au début de l’année 1942. C’est ainsi qu’ils parvinrent à fausser compagnie à leurs geôliers et se dissimulant dans des wagons, traversèrent le sud de l’Allemagne, l’Est de la France, et parvinrent à Paris, à la gare de l’Est. Dénoncés par des cheminots, ils allaient être remis aux Allemands, lorsqu’ils parvinrent, à nouveau à s’échapper après avoir neutralisés leurs délateurs. C’est à pied qu’ils purent franchir la ligne de démarcation, malgré la poursuite d’une patrouille allemande, pour finalement arriver à Carcassonne en février 1942.
Hélas, quelques mois plus tard, les allemands arrivaient et se mirent à rechercher les prisonniers de guerre évadés. Charles changeait alors d’identité et commençait à organiser la résistance locale sous le pseudonyme de « Roland ». Dés le début de l’année 1943, Cécile intégrait le réseau clandestin « Franc Tireur ». Outre la diffusion de la presse clandestine, Cécile assurait le secrétariat du chef départemental de la résistance, Jean Bringer, alias « Myriel ». C’est au PC clandestin de celui-ci, situé dans un appartement au dessus de l’ancienne droguerie « Arnal », Boulevard Omer Sarraut qu’elle dactylographiait, les instructions aux maquis, aux chefs de groupes et les comptes-rendus à la hiérarchie clandestine. Dans ce local, armes, munitions et archives étaient entreposés. Outre Charles Fourès, fréquentait également ce lieu clandestin de réunion, son ami Jean Delpech, qui fut durant des décennies Secrétaire Général de la Mairie de Carcassonne.Mais son rôle ne se bornait pas à des tâches administratives sensibles ; elle jouait également les agents de liaison, acheminant elle-même, nombre des messages qu’elle avait tapé sur sa machine à écrire.
Elle détenait tous les secrets et, les transportant, exposait sa vie dans une ville où les patrouilles étaient fréquentes. Contrôlée à plusieurs reprises elle s’en sortait chaque fois grâce à son charme et à son sourire, bien sûr, mais également grâce à son jeune âge. Comment imaginer qu’une aussi jeune fille puisse transporter le courrier des « terroristes gaullistes» ? Ses messages cachés dans le guidon de sa bicyclette parvenaient régulièrement à leurs destinataires. Avec discrétion et ponctualité elle accomplit son travail de l’ombre, risquant sa vie pour son pays. Car les risques étaient bien réels.
En effet, la Gestapo décida de décapiter la résistance audoise. Ayant identifié leur chef, Jean Bringer, ils l’arrêtent le 29 juillet 1944 ainsi qu’un de ses adjoint, officier de police, Aimé Ramond. Ils mettent en place une souricière autour de la droguerie Arnal, mais l’alerte ayant été donnée, Cécile échappe à l’arrestation alors qu’elle s’y rendait.
Les allemands évacuent la ville le 20 août. La veille, ils fusillent Jean Bringer et dix- sept de ses camarades à Baudrigues, dépôt de munitions situé près de Roullens, où ils placent les corps sur des explosifs et font sauter les dépouilles des victimes.
Femme de devoir, Cécile Fourès a fait honneur à la ville de Carcassonne. Fille et veuve de médaillé militaire, titulaire de la Croix de guerre 39/45 et de la Croix du Combattant, Volontaire de la Résistance, ses états de service militaires validés vont du 1er janvier 1943 au 30 août 1944.

Monsieur Caby, alors directeur de l’Office Départemental des Anciens Combattants écrivait dans la proposition pour la croix de chevalier de l’Ordre National du Mérite :
"Cécile Fourès, a rendu, au péril de sa vie, d’éminents services à la Résistance"
Femme de devoir, elle a continué à servir son pays en s’impliquant de façon très active au sein de nombreuses associations. Son dévouement et son passé élogieux de combattant d'être élevée au grade de chevalier de l’Ordre National du Mérite » en 2006.

Les obsèques de Cécile Fourès au cimetière Saint-Vincent, le 11 août 2020. Son arrière petit-fils présente les décorations devant le cercueil en présence des porte-drapeaux.
A son fils Jean-Pierre et à l'ensemble de sa famille nous présentons nos condoléances les plus attristées. Un acteur engagé contre la barbarie nazie vient de s'éteindre au moment où justement, une partie des européens semblent oublier les conséquences du nationalisme sur l'humanité.
___________________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020