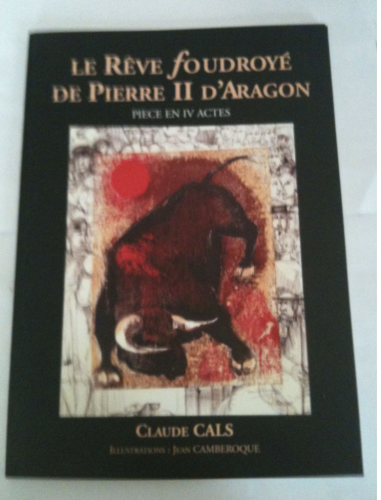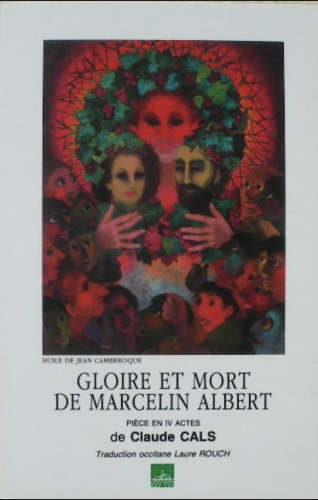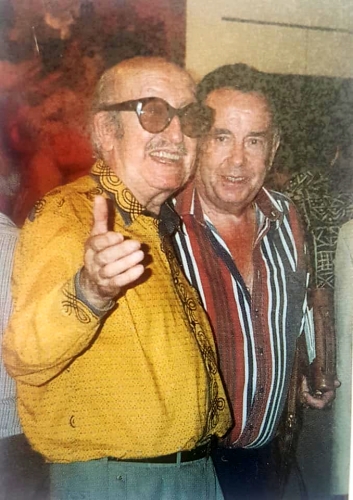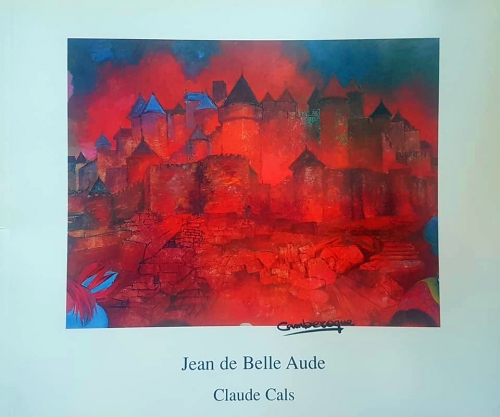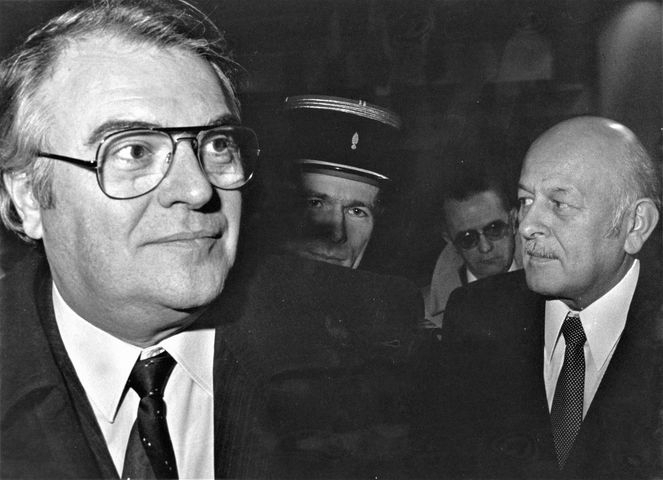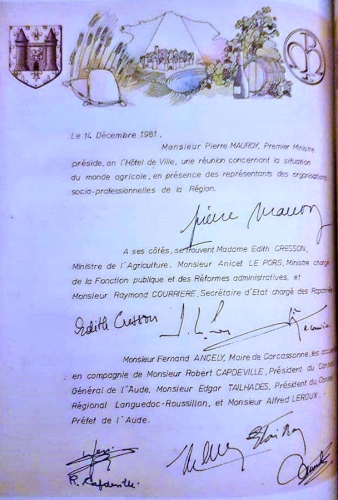Dimanche matin, le téléphone sonne… "Allo ! C’est Charlotte Julian. Oh ! Comme c’est aimable à vous de me rappeler, lui dis-je. Cela fait un moment que j’essaie de vous contacter afin que vous me parliez de votre frère, Claude. Certains de mes amis Carcassonnais m’ont souvent parlé de lui, sans qu’il me soit possible de retrouver sa trace." Ainsi s’enchaîne une conversation de près d’une heure avec Charlotte Julian, artiste dans tous les sens du terme : Chanteuse, actrice et depuis plusieurs années, peintre. Celle qui avait quitté Perpignan dans sa jeunesse pour monter à la capitale vit aujourd’hui à Cannes, où elle peint de belles toiles d’art naïf désormais cotées chez Drouot. « La petite fleur de province » n’a rien perdu de sa gentillesse, ni de son humilité et lorsqu’on cherche à parler de son frère, on ressent une grande admiration pour lui. "C’est un pur, affirme t-elle. Ni l’argent, ni la gloire ne le préoccupent ; s’il a de quoi vivre cela lui suffit pourvu qu’un chevalet se dresse avec sujet à peintre. Le soucis du détail, de la couleur et surtout de la perfection. Jamais il ne cèdera une de ses toiles, s’il la juge non achevée, dit-elle."

© enchères-occitanes.fr
Les parasols (1976)
De quinze ans son aîné, Claude Julian voit le jour le 8 août 1935 à Perpignan dans une famille nombreuse au sein de laquelle il n’y a pas le sou, mais beaucoup d’amour parental. A l’école des Beaux-arts de la capitale catalane où sa sœur Charlotte suivra ses pas, le jeune homme démontre de grandes capacités pour le dessin. "Mon frère, c’est avant tout un extraordinaire portraitiste, proclame Charlotte. A mes débuts dans la chanson, il a réalisé mon portrait que je garde précieusement chez moi."

Charlotte Julian par son frère
En 1964, Claude Julian illustre le célèbre roman d’Alain Fournier Le grand Meaulnes, aux éditions de la Source : In folio en feuilles, illustré de 19 aquarelles originales (dont 2 à pleine page) peintes sur chaque exemplaire. Un exemplaire de ce livre d’art estimé à 500€ s’est récemment vendu aux enchères à Bordeaux.

© Charlotte Julian
Aquarelle de Claude Julian
A Saint-Paul-de-Vence, à l’époque où le peintre Marc Chagall habite le village et où le couple Montand-Signoret vient s’y détendre, Claude Julian obtient le Premier grand prix de peinture dans la série Compositions. S’ensuit de nombreuses sollicitations afin que l’artiste catalan expose dans de célèbres galeries helvétiques.

© Charlotte Julian
Toile de Claude Julian
A Carcassonne où il vient s’établir dans les années 1970, il rencontre un vivier d’amateurs d’art investis dans la culture locale. Parmi ses grands admirateurs, nous citerons le docteur Emile Delteil. Le patron de la clinique du Bastion garde en son domaine du Majou près de Montréal d’Aude, une villégiature où Claude Julian est régulièrement invité. Le Dr Delteil comme tout collectionneur avisé sait dénicher les talents de demain ; ceux dont la cote sera promise à un bel avenir. Après la disparition du médecin, de nombreuses toiles de Julian iront garnir le salon de la maison du directeur, héritier de la clinique. Claude Julian avait également trouvé en Georges Glardon, célèbre galériste installé dans la rue Aimé Ramond, un soutien de poids et de nombreux acquéreurs parmi les plus fortunés de la ville. Etaient-ils tous poussés par leur enthousiasme, ou bien par un bon placement ? L’incompris c’est souvent l’artiste… Souvenons-nous d’Alain Clinard.
Reportage sur Collioure en 2012 où figure Claude Julian à la fin
Revenu dans son pays catalan, Claude Julian s’installe dans le village des peintres à Collioure, puis à Port-Vendres. C’est là qu’aujourd’hui, on peut le trouver face au port en train d’achever l’une de ses toiles. A 85 ans, l’artiste passionné vit ainsi dans un quasi anonymat. Toutefois, si son nom ne parle à personne là-bas, il n’est pas un touriste amateur d’art qui ne perçoit son extraordinaire talent. Hélas ! Comme le précise avec tristesse sa sœur Charlotte, "les experts ne s’intéressent pas à la peinture de mon frère parce que ses toiles ne sont pas sur internet." Espérons que cet article donnera une visibilité à l’oeuvre de cet extraordinaire coloriste.
Je remercie vivement Charlotte Julian pour sa disponibilité et sa gentillesse.
____________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020