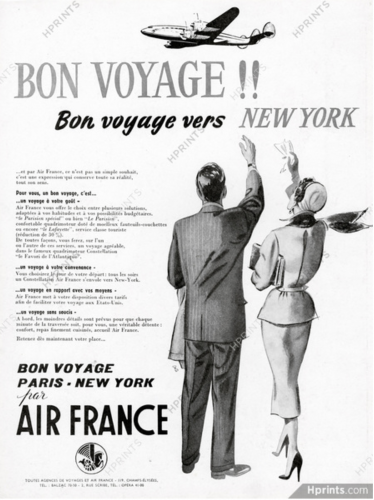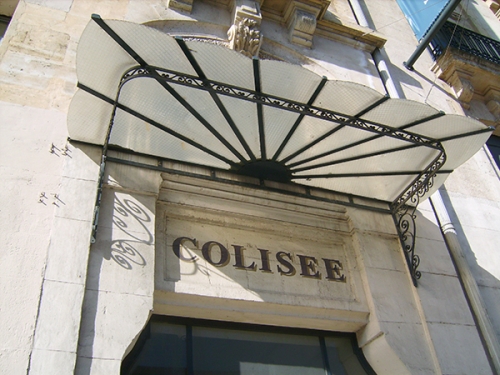Si vous prenez souvent la route de Toulouse en direction du centre commercial Leclerc, peut-être avez-vous remarqué sur votre droite avant d'arriver au rond-point Pompidou un ancien moulin. Il s'agit du Moulin de Cers du domaine de Cucurnis. Bien entendu, tout ce qui l'entoure est désormais une zone pavillonnaire mais ce n'était pas le cas il y a encore 30 ans...

Cette photographie a été prise en remontant du rond-point Georges Pompidou vers la ville, car on voit mieux le moulin sur la gauche. Pour y aller directement, descendez et prenez la dernière à droite avant le rond-point. Vous serez alors sur l'ancien chemin menant au domaine de Cucurnis, avant que la rocade ne vienne le fracturer et le couper.

© Darcy Végas
Voici une vue du moulin dans son jus au début des années 1980 quand les vignes lui donnaient encore un aspect champêtre. On dirait même que les arbres à l'intérieur lui faisaient un coiffure Rock and roll. Bref, ce champ avait la banane avant d'être bitumé... L'ancien chemin menait au domaine de Cucurnis situé en contre bas de l'actuelle rocade ouest. Il fut créé à la fin du XVIIe siècle par la famille Rivals, mais ce sont les nouveaux propriétaires M. Cucurny ou Cucurnis qui lui donneront ce nom. Par alliance la famille Blanc en hérite au XIXe siècle, reprend l'exploitation maraîchère et plante quelques vignes. Les anciens se souviendront que M. Blanc était le plus important producteur de melons. Il venait les vendre sur le marché de la place Carnot. Son fils, Jean Blanc, est Docteur en histoire et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Carcassonne et sur le département de l'Aude.

© Darcy Végas
Ce moulin à vent avait paraît-il conservé sa meule à l'intérieur et pendant la seconde guerre mondiale, c'était une cache pour les résistants carcassonnais. Les restes rouillés d'un char d'assaut allemand sont même restés longtemps en bordure de ce champ.

Le journal La dépêche dans son édition du 8 janvier 1986 avait alerté l'opinion publique sur les risques de voir disparaître ce moulin, suite à la création prochaine d'un lotissement à cet endroit. Sur ce terrain de 56 lots appartenant à Deviq, le constructeur Fougerolles fut contraint de s'intéresser au moulin. La dépêche sous la plume de Jacques Arino, un ancien du quartier, écrivit : "En un mot comme en cent, ce moulin, même s'il n'a pas de valeur architecturale importante, fait partie d'un patrimoine culturel et sentimental inscrit dans la mémoire collective de notre idéntité régionale ; en ce sens, il mérite notre attention à tous. Certes, on peut laisser tout disparaître sans crier gare. A ce titre, il faut se souvenir que la Cité, elle aussi, faillit voir ses ruines rasées à une certaine époque." Ah ! C'était l'époque où les journalistes de ce quotidien faisaient autre chose que la sortie des tribunaux et des commissariats pour concurrencer Ici, Paris ou Détective....

La décision de le détruire aurait bien actée sans l'intervention de Jacques Arino, car M. Thomas des Maison Fougerolles s'était exclamé : "En ce qui nous concerne, il va de soi que nous ne pouvons laisser subsister une telle verrue dans un quartier qui aura vocation résidentielle." Alors M. Roland Gonzalez pour l'agence Deviq ajouta : "Nous ferons le maximum pour préserver le site. Le moulin en particulier sera parfaitement mis en valeur à l'entrée du lotissement. Les maisons placées à l'entrée seront des maisons sans étage mais avec mezzanine."

Une vue en 1980 de la route de Toulouse (N113) et du moulin de Cers sur la droite. A droite, la rocade ouest au début de sa construction et le champ dans lequel on construira plus tard le centre E. Leclerc.

Le même endroit en 2020
Et comme de bien entendu, l'administration a changé le nom de Cucurnis en Cucurlis pour le chemin menant au moulin. Notez bien ! CUCURNIS avec un N.
_____________________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020