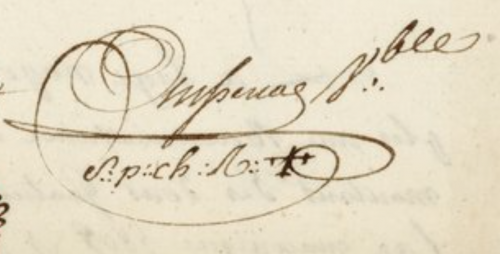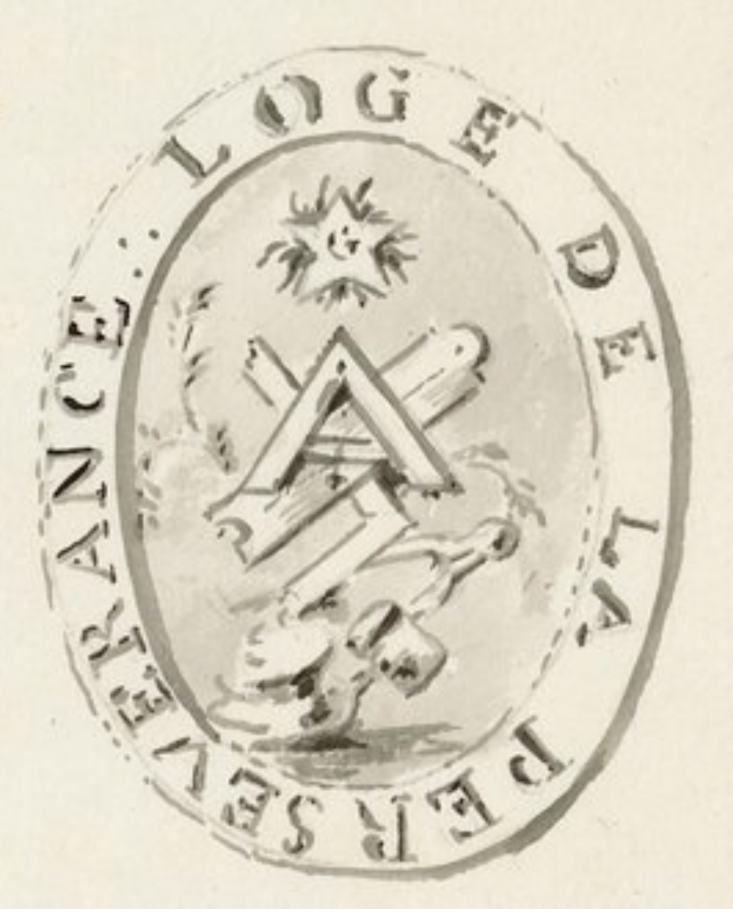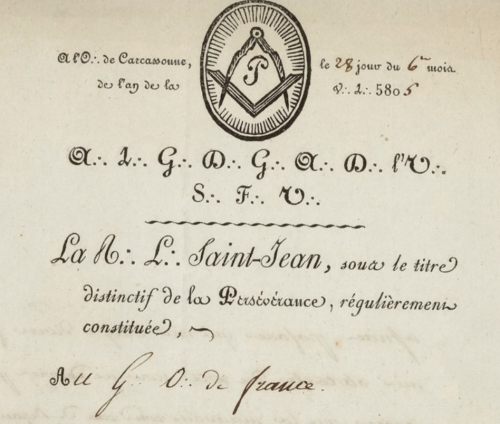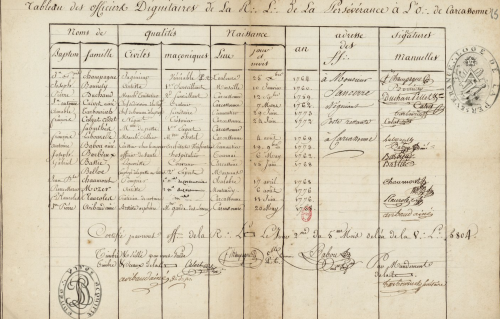Monseigneur VALENTIN,
Je vous écris en tant que paroissienne de l’Église Saint-Joseph à Carcassonne, profondément préoccupée par la direction que prend actuellement la gestion de nos lieux de culte, ainsi que par les rumeurs récentes concernant la fermeture de certaines églises et l’organisation d’un spectacle "son et lumière" à l’église Saint-Vincent. Ces rumeurs et/ou décisions, que je perçois comme arbitraires, menacent l’équilibre spirituel et social de notre communauté.
Il est important de rappeler que le rôle de l’évêque, selon le Canon 491 du droit canonique, est d’assurer un ministère pastoral "avec une grande prudence" et de "veiller à la stabilité de la vie chrétienne" dans le diocèse. En prenant des décisions qui affecteraient profondément la vie spirituelle de notre communauté, telles que l'éventuelle fermeture de l’église de Saint-Joseph ou de l’église du Sacré-Cœur, vous mettriez en péril cette stabilité, essentielle au bien-être spirituel des paroissiens.
Le Canon 217 nous rappelle que les pasteurs ont une responsabilité particulière dans l'édification de l'Église et la croissance spirituelle des fidèles. La fermeture d’églises compromet cette mission en réduisant les espaces de prière et de recueillement nécessaires à une communauté chrétienne.
Le Canon 1270 nous indique également que l’évêque doit être attentif à la situation des fidèles et à leur bien-être spirituel. La suppression d’une église ou la délocalisation des services religieux dans un contexte où la majorité des paroissiens sont des personnes âgées, souvent sans moyens de transport pour accéder à d’autres lieux de culte, va à l’encontre de ce principe. Si l’église de Saint-Joseph ou celle du Sacré-Cœur, lieu de prière et de recueillement pour beaucoup, se retrouvent fermées, où iront ces paroissiens ?
De plus, le Canon 1336 stipule que des actions doivent être prises pour préserver l’unité et l’harmonie de l’Église, en tenant compte de la situation des fidèles, sans négliger l’importance des structures locales. Prendre des décisions sans consulter pleinement la communauté et sans analyser les conséquences sur l’équilibre spirituel de celle-ci ne peut que fragiliser cette unité.
Je tiens également à attirer votre attention sur la situation de l’église Saint-Vincent. Il est prévu qu’un spectacle "son et lumière" y soit organisé, retraçant l’histoire de l’édifice à l’époque post-médiévale, une expérience immersive créée par l’agence Cultival et le studio multimédia Moment Factory. Bien que ce projet puisse avoir un intérêt culturel indéniable, il soulève plusieurs interrogations quant au respect du caractère sacré du lieu. Pourquoi organiser un tel spectacle à l’intérieur de l’église ? Ne serait-il pas plus approprié d’envisager cette expérience immersive à un autre endroit, comme sur les façades extérieures de l’église ou dans d’autres lieux publics, afin de préserver l'intégrité spirituelle de l'église tout en valorisant le patrimoine historique de la ville ?
Cette initiative, si elle est mise en œuvre, pourrait avoir pour conséquence la privation de trois églises au total de leur vocation spirituelle dans une ville déjà confrontée à des défis socio-économiques : l’église du Sacré-Cœur à Grazailles, l’église de Saint-Joseph à Carcassonne, et l’église de Saint-Vincent. Cette concentration d’églises fermées ou détournées de leur vocation religieuse semble disproportionnée et profondément injuste pour une communauté comme la nôtre, qui compte sur ces lieux pour maintenir le lien avec la foi et la pratique religieuse.
À cela s’ajoute une pétition récemment lancée sur internet, qui a recueilli plus de 6 000 signatures (l’Indépendant), avoisinant les 9 000 à l’heure où je vous écris, exprimant le refus catégorique de l’organisation d’un spectacle "son et lumière" à l’église Saint-Vincent, et plus largement la crainte que ces initiatives affectent l’identité spirituelle de nos lieux de culte. Cette mobilisation témoigne de la profonde inquiétude et du désaveu général quant à la direction que prend la gestion de nos églises.
Comme le Canon 1389 le stipule, l’abus de pouvoir est un grave manquement, et prendre des décisions sans consulter adéquatement la communauté pourrait être perçu comme tel. En outre, selon le Canon 212, les paroissiens ont le droit de manifester librement leurs besoins et souhaits concernant la gestion des affaires de l’Église. Il semble que ce droit n’ait pas été pleinement respecté, puisque, jusqu’à présent, aucune consultation transparente n’a été réalisée avant les rumeurs ou les pseudo-décisions concernant ces questions.
Nous sommes également préoccupés par le fait qu’en l’espace d’un an, plusieurs décisions lourdes ont été prises sans véritable concertation réelle avec la communauté. Une large majorité des paroissiens, et non seulement la communauté gitane comme cela a été rapporté dans un article médiatique, s’est opposée à la mutation de prêtres profondément enracinés dans la vie de notre paroisse. Ces prêtres étaient aimés et respectés par tous, et leur départ a créé une atmosphère de malaise, d’incompréhension et de méfiance au sein des paroissiens. Il apparaît que des tentatives de manipulation médiatique ont eu lieu, visant à faire porter la responsabilité de l’opposition uniquement à la communauté gitane, alors qu’elle provenait d’une large part de l’ensemble de la paroisse. Ces changements imposés, sans la transparence requise, ont profondément ébranlé notre confiance et l’unité de notre communauté.
En tant que paroissiens, nous avons le droit, et même le devoir, de défendre ces espaces sacrés qui ont une importance historique et spirituelle. La loi de 1905, tout en encadrant la séparation de l’Église et de l’État, rappelle que les lieux de culte doivent être respectés dans leur vocation première. Il semble difficile d’accepter qu’une politique de fermeture et de délocalisation des églises soit menée sans prendre en compte les besoins spirituels des paroissiens et l’impact sur notre foi locale.
Je vous demande donc instamment de reconsidérer les éventuelles fermetures de l’église de Saint-Joseph, de l’église du Sacré-Cœur, si les rumeurs étaient fondées, ainsi que l’autorisation d’un spectacle "son et lumière" à l’église de Saint-Vincent, et de vous assurer que toute décision à ce sujet soit prise avec la pleine consultation des paroissiens et dans le respect des principes du droit canonique.
Dans l'éventualité où aucune révision sérieuse et transparente ne serait effectuée concernant ces décisions, je vous prie respectueusement de prendre en considération que nous serions amenés à porter cette situation à l’attention des autorités compétentes, y compris les instances supérieures de l’Église, comme le Saint-Siège, afin de garantir que les droits des paroissiens et l’intégrité spirituelle de notre communauté ici à Carcassonne soient préservés.
Je vous remercie infiniment pour l’attention que vous porterez à ce mail, et vous prie d’agréer, Monseigneur, l’expression de mes salutations respectueuses et dévouées.
Si vous souhaitez écrire à La Nonciature ou à l'archevêque de Montpellier, voici les adresses mails nuntius.france@gmail.com ou secretariatarcheveque@diocese34.fr
Si vous souhaitez signer la pétition, cliquez ci-dessous
Pétition à signer
_____________________________________
Les travaux de rénovation de la place Eggenfelden près des Halles, vont débuter demain. Or, sur le visuel fourni par la ville de Carcassonne la matérialisation de l'emplacement du pilori a disparu. Au centre de la place, un cercle de galets définit depuis toujours l'ancien pilori où l'on mettait les condamnés. D'ailleurs, une plaque historique contre la façade des halles en relate l'histoire. Voilà encore un pan de notre histoire locale qui n'est plus pris en considération.

La place Eggenfelden telle qu'elle est prévue.

L'actuelle matérialisation du Pilori
_______________________________________
Que devient-elle ? La Samaritaine, l'emblématique statue qui ornait la fontaine de la rue du Pont vieux a été déposée depuis dix ans pour être restaurée. Elle n'est toujours pas revenue à sa place et aucun projet ne semble sortir du chapeau municipal pour son retour. J'avais suggéré que l'on organisât un concours avec l'Ecole des Beaux-arts de Toulouse pour la remplacer. A l'évidence, c'est resté lettre morte.

La Samaritaine, rue du Pont vieux en 2015
_______________________________________
On apprend en coulisse que M. Dupont, le directeur du patrimoine de la ville et par ailleurs, celui du Pôle culturel, aurait obtenu pour mission de faire restaurer la fontaine de la Place Carnot d'ici décembre. Que l'on confie le dossier de restauration à celui qui a fait passer Neptune au sablage en 2007 et qui fait poser la patinoire sur la fontaine chaque hiver, c'est plus alarmant.
Article de La dépêche en cliquant ci-dessous
Article de 2007 - La dépêche

La fontaine de Neptune est régulièrement décorée comme objet de chez GIFI chaque hiver.
__________________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2025