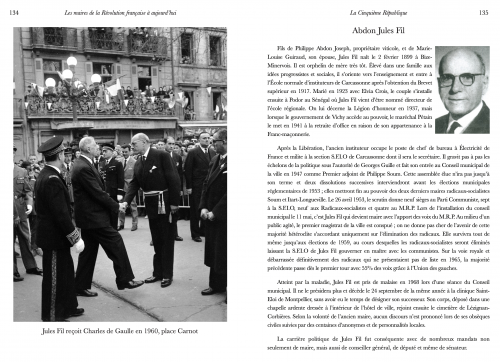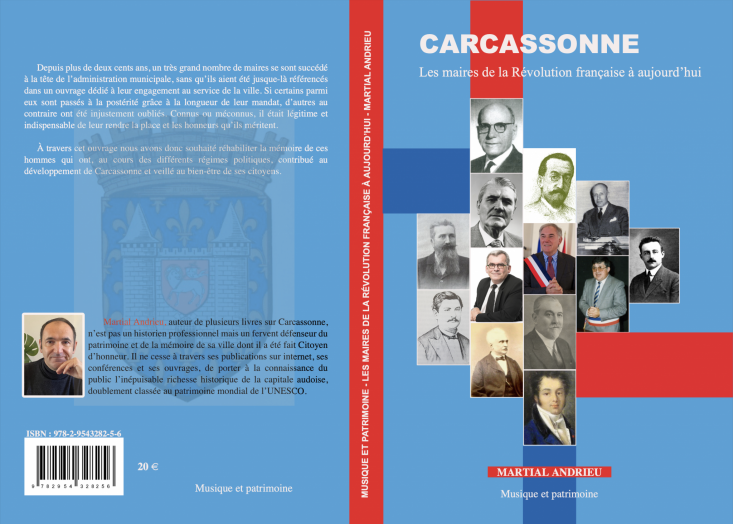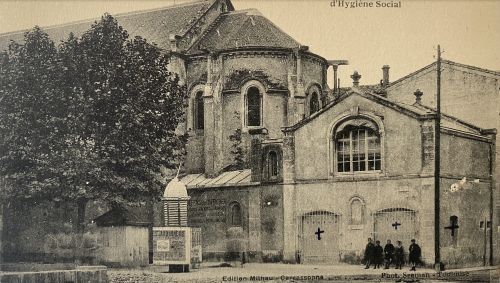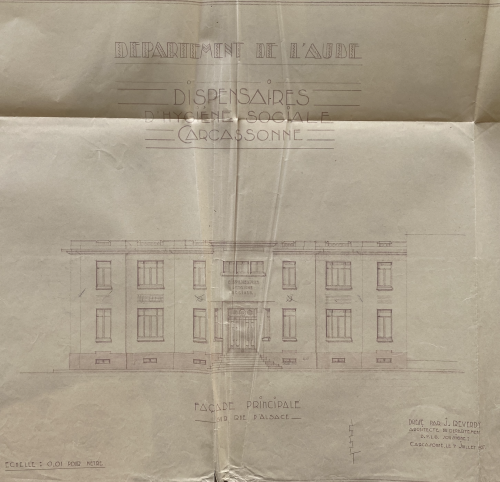On n’a pas beaucoup écrit de choses sur le domaine de Prat-Mary, appelé improprement du nom du marquis de Gonet puisqu’il ne l’a pas fait construire. Malheureusement, les quelques paragraphes qui sont parus dans la presse ou ce que certains ont pu en dire, comportent des erreurs historiques et généalogiques. A commencer par la référence de tout historien local : Alphonse Mahul. L’auteur du célèbre Cartulaire prétend que le domaine fut vendu en 1825 par un dénommé Chabaud, boucher de son état, à Monsieur Mary, ingénieur du cadastre. Ce dernier, à sa mort, en aurait fait don à son gendre M. Malric, agent-voyer en retraite.
Nous sommes mis en quête de savoir quels étaient les prénoms des sieurs Chabaud, Mary et Malric. Après quoi, nous avons ouvert notre enquête généalogique et historique de la manière la plus sérieuse par les moyens accoutumés. Il se trouve qu’effectivement le ville de Carcassonne possédait en ses murs des bouchers du nom de Chabaud ; le plus âgé d’entre eux à cette époque fut Jean-Pierre Chabaud (1752-1808). Marié en 1774 avec Jeanne Jean Bernard, le couple résidait à l’angle de la rue Joséphine (Liberté) et de la préfecture (Bringer) et élevait ses huit enfants : Guillaume, Rose, Catherine, Alexis-Esprit, Jeanne, Marie, Paul et Rose. Lorsqu’on se penche dans les affaires judiciaires de la famille conservées dans la série J dans des archives départementales de l’Aude, on s’aperçoit que les enfants mirent longtemps à régler les problèmes de succession après la mort de leurs parents. Nous vous épargnerons les fastidieux détails d’une querelle familiale ; ce n’est pas le sujet qui nous préoccupe. En revanche, l’inventaire successoral nous apprend que le couple Chabaud possédait de nombreuses terres cultivables. Parmi elles, l’épouse avait reçu en héritage familial un pré, situé en bordure de la route de Limoux, partagé en deux à cause du passage de l’aqueduc de Pitot. D’une contenance de cinq sétérées, soit environ 1,2 hectares, ce terrain que nous voyons ci-dessous, n’avait pas de construction en 1808.

En 1780, le domaine n'est pas encore construit en bordure de l'aqueduc et de la route de Limoux.
Après vérification, il s’agit bien de l’emplacement de l’actuel domaine. Mahul nous dit que M. Chabaud en était le détenteur au moment de sa cession à M. Mary ; c’est inexact. Les enfants Chabaud ne souhaitant pas que les produits de l’héritage restent en indivision, ils furent mis en adjudication au plus offrant. L’aîné de la famille, Guillaume Chabaud, porta une enchère sur ce pré, mais c’est finalement son beau-frère Jean-François Bourdel (1771-1846), époux de Rose Chabaud (1782-1864), qui la remporta pour 10 000 francs. Ce n’est donc pas M. Chabaud qui a pu vendre à M. Mary en 1825, un domaine qui n’existait pas encore. Celui-ci s’est construit quelque temps après, grâce à Jean Mamert Mary, géomètre du cadastre et non pas ingénieur.

L'initiale de Jean Mamert Mary
Là encore, tordons le cou à une confusion qui s’est propagée avec Jean-Louis Bonnet. Il s’agit de Jean Mamert Mary (1791-1876), résidant au Pont vieux, et non de Jean-Baptiste Mary (1813). En revanche, c’est Jean-Baptiste Malric dont la famille de juriste n’était pas originaire de Castelnaudary, mais de Renneville en Haute-Garonne qui en héritera. Jean Mamert Mary a fait bâtir ce domaine après 1825 qui est devenu Prat-Mary (Le pré de Monsieur Mary) ; c’est une explication probable du nom. Il possédera en 1855, le domaine de La conte.

Le couple Mary dont l’épouse Jeanne Cordes venait de Conques-sur-Orbiel, avait eu deux enfants qui n’atteignirent pas l’âge adulte. Sans héritiers directs, le domaine alla à la nièce de Jeanne Cordes, c’est-à-dire à Jeanne Mélanie Cordes, épouse de Jean-Baptiste Malric. Le domaine agricole de Prat-Mary sera exploité par des métayers sous la propriété d’Henri Malric (1844-1938), avocat et juge au tribunal civil de Carcassonne de 1872 à 1914. Cet homme brillant, inscrit au barreau depuis 1863, s’éteignit le 22 janvier 1938 avec le titre honorifique de Doyen des avocats de France. Comme Henri Malric avait eu la douleur de perdre son fils Achille, officier de cavalerie, le 21 janvier 1935, il était dépourvu d’héritier direct.

© J. Blanco
Le domaine de Prat-Mary tomba en 1948 entre les mains d’Henriette Malric-Cazes († 1983) qui avait épousé Charles de Gonet (1919-2006), avocat. Le jeune homme à « la voix d’or » fréquentait à Béziers le foyer artistique de Gustave Fayet, le célèbre mécène et collectionneur d’art qui mourut à Carcassonne en 1925 dans la Villa Blanche. C’est chez Fayet que Charles de Gonet rencontra Henriette Malric-Cazes ; elle lui apporta en dot le domaine de Prat-Mary. Dès lors, le jardin de ce domaine fut transformé avec soin par Charles de Gonet, marquis du même nom. Ce dernier cultivait avec délicatesse les secrets de l’art topiaire. La ville de Carcassonne est désormais propriétaire du domaine du marquis de Gonet, dont la bâtisse n’est pas du XVIIIe siècle comme cela a été écrit. Le portail d’entrée porte l’initiale M de son premier propriétaire Jean Mamert Mary.
Sources
Cartulaire de Mahul
Prat-Mary au temps du marquis / L’Indépendant
Video / JL Bonnet / Mairie de Carcassonne
Etat-Civil / ADA 11
138J138 et 137 / ADA 11
Plan du Canal royal du Languedoc / Archives de l’Hérault
La vie de Gustave Fayet
Nous regrettons de n’avoir pas pu consulter l’indispensable source d’archive de la famille de Gonet et de son domaine, conservée aux Archives départementales de l’Aude sous la cote 136J. Documents successoraux et la vente des terrains au domaine public. En effet, après avoir trouvé les documents décrits ci-dessus, M. JL Bonnet en a fait don en son nom aux archives de l’Aude. Il a fait mettre une protection de 50 ans qui défend à quiconque de les consulter, à part lui.