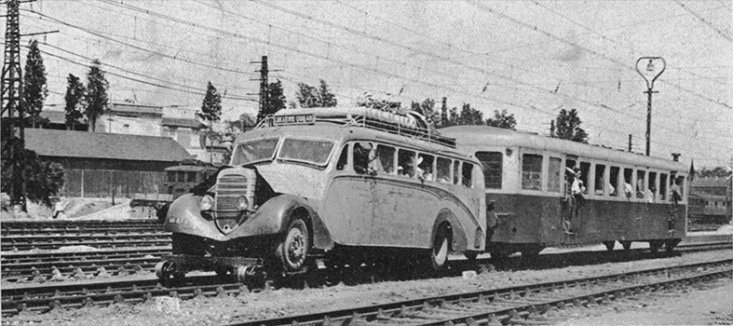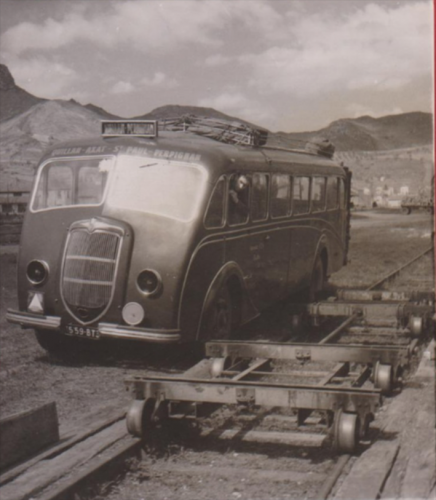Paul, Emile Enderlin est né le 23 août 1888 à Paris (XIVe) au sein d’une famille dans laquelle le père est sculpteur. C’est peut-être pour cela qu’il tente à plusieurs reprises le concours d’entrée à l’Ecole des Beaux-arts avant finalement d’y être admis le 5 janvier 1909. Il fait partie de l’atelier de Gustave Umbdenstock (1866-1940). La Grande guerre, au cours de laquelle il se distingue par sa bravoure, lui vaut plusieurs citations de l’armée mais freine ses études. Ce n’est qu’en novembre 1920 qu’il obtient son diplôme d’architecte. Quatre ans après, il se marie avec Hélène Balanec et le couple s’installe à Carcassonne dans l’ancien cabinet de G. Vidal, 20 rue Antoine Marty.

L'Odéum dans les années 1930
Dès lors, Paul Enderlin va s’illustrer par un grand nombre de réalisations dans Carcassonne à l’époque de la municipalité d’Albert Tomey. En 1927, l’architecte dresse les plans de la salle de l’Odéum que beaucoup de Carcassonnais connaissent pour avoir été un cinéma. Pas seulement… Ce bâtiment Art Déco avec ces colonnes très inspirées de la Grèce antique fut utilisé pour diverses manifestations : Galas de boxe (1933), meetings politiques du parti radical (1937), réunions des nationalistes comme Philippe Henriot (1936) et des légionnaires contre le bochévismes (1941), etc. N’oublions surtout pas qu’Odeum signifie en latin, le lieu où l’on chante. Tino Rossi y poussa la chansonnette pendant la Seconde guerre mondiale.
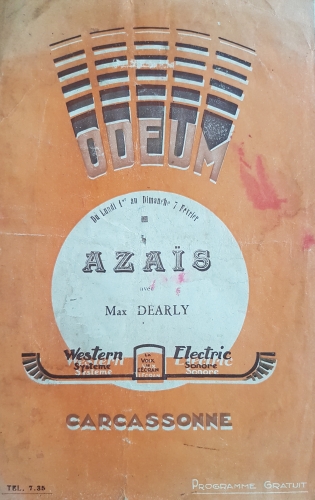
Programme de 1931
Il est toutefois exact que ce lieu culturel fut exploité en salle de cinéma par M. Deumié ; on y vit le premier film parlant le 3 septembre 1930 avec Maurice Chevalier grâce au procédé sonore de la Western Electric.

L'Elysée à Limoux
Sur un modèle architectural qui lui ressemble, on citera le cinéma l’Elysée à Limoux dont l’œuvre est aussi de Paul Enderlin en 1929.
Dans Carcassonne, les bâtiments publics réalisés par Enderlin (Groupe scolaire Jean Jaurès, Collège Varsovie) se succèdent aux édifices privés. Ils sont beaucoup moins connus et Claude Marquié dans sa chronique de La dépêche en 1999, nous en cite quelques uns : Pharmacie Billot à l’angle des rues de Verdun et Jean Bringer, Immeuble Daraud à l’angle des rues Courtejaire et Ramond, etc. Plus loin de chez nous, retenons le monument aux morts d’Orsennes dans l’Indre.

L'immeuble Enderlin, square Gambetta
La famille Enderlin vivait dans une belle maison au n°5 bis, square Gambetta. Sous l’Occupation, Paul Enderlin aura la mauvaise idée de devenir membre régional de l’Ordre des architectes créé par le gouvernement de Vichy le 31 décembre 1940. Il adhère le 28 mai 1941 et représente le département de l’Aude. A la Libération, il sera relevé de ses fonctions d’architecte municipal et révoqué par le Comité d’Epuration de l’Aude. Cela ne l’empêcha pas de participer dans les années 1960 à la construction de la Cité Saint-Jacques à Carcassonne.
A n’en pas douter, Paul Enderlin, dont le nom ne dit plus rien à personne, reste un architecte talentueux qui nous a légué un patrimoine Art Déco des plus remarquables. Il est décédé en 1969.
Sources
Base de données de l'Institut national d'histoire de l'art
Archives de la Libération / Fonds Vals
L'éclair, juillet 1941
Photo en Une : J-L Bibal / DDM
________________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019