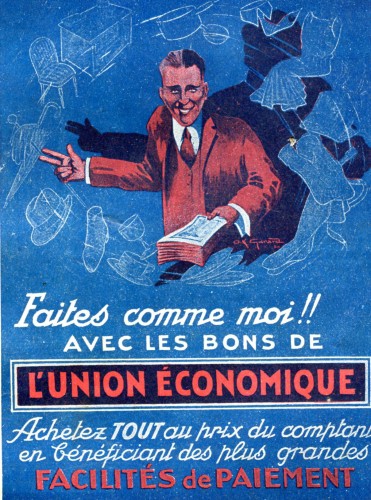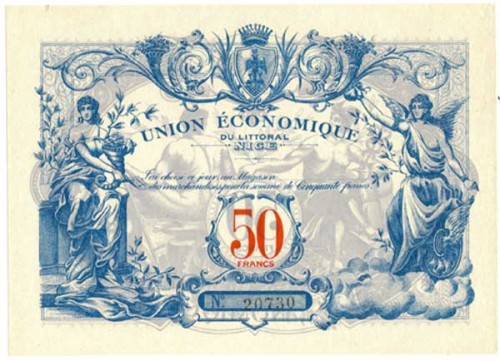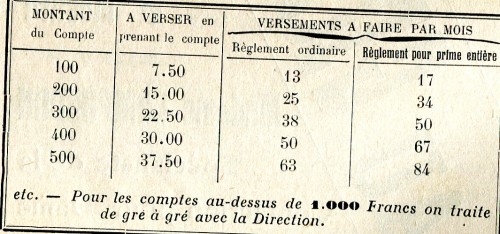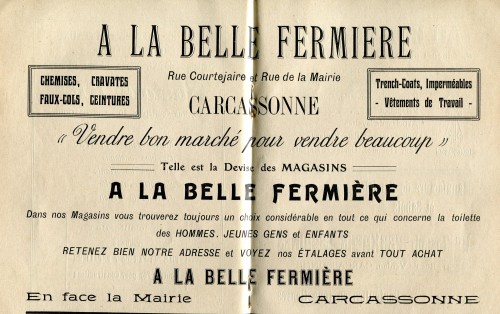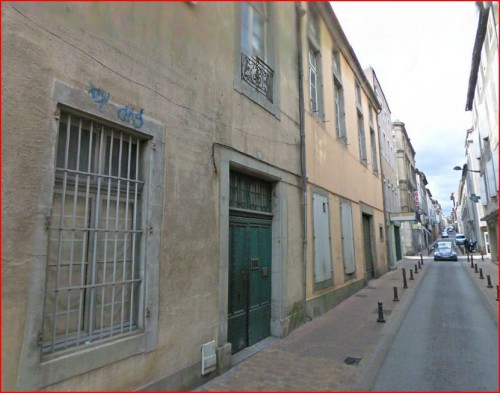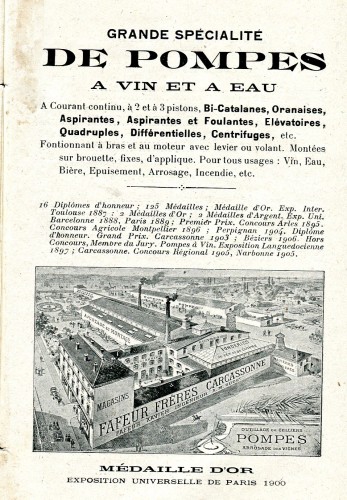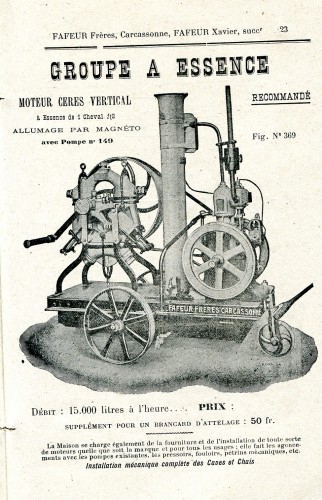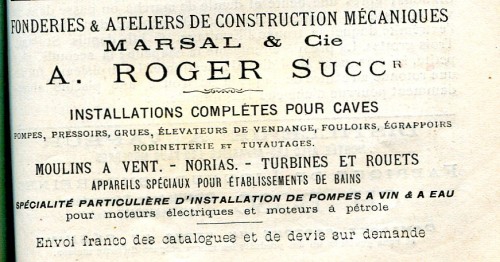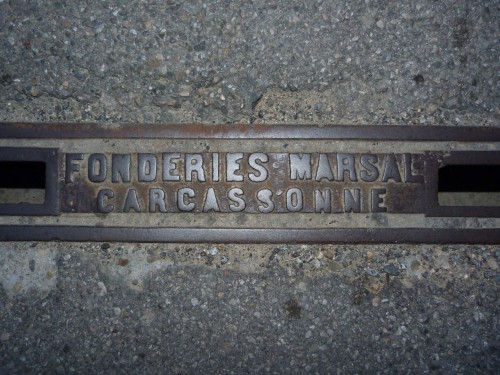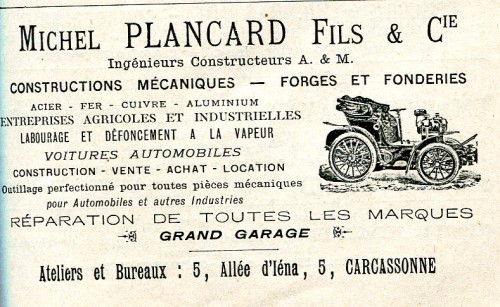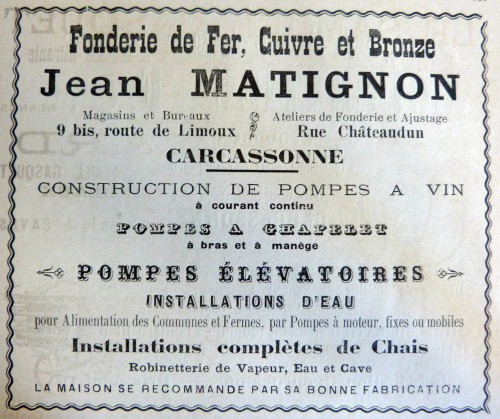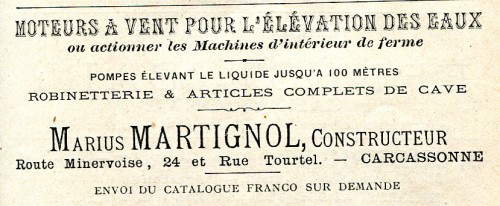Il est loin le temps où les jeunes carcassonnais se ravitaillaient à la bonbonnerie Marseillais de M. Raynaud sur le boulevard des tilleuls (Commandant Roumens). C'était au début du siècle dernier, à côté du Bazar du Bon marché et du café du Helder (café des platanes). Jusqu'à la libération et à la destruction du square gambetta par l'occupant, deux kiosques en pierres se tenaient parallèlement au jardin. Le premier, en face du musée était tenu par M. Andrieu. Le second, celui de Mlle Delphine, lui faisait concurrence en face de la maison Lacombe. Faut dire qu'il fallait du stock en réglisses, guimauves et autres sucettes pour les écoliers du groupe scolaire Jean Jaurès, inauguré en 1928. Ces kiosques ont été détruits comme celui qui à l'identique est resté quelques temps après place Davilla.

A partir du boulevard Barbès, en face le café du Midi (détruit), il y avait l'étal de madame Gillot surnommée "la japonaise" par les enfants, en raison de sa coupe de cheveux.

Comme elles étaient délicieuses les sucreries de madame Bourrel... Juste après la guerre, la marchande de bonbons avait posé son étal dans la rue de la gare en face du Continental, pour la grande joie des enfants. Elle vendait des cocos, des bonbons acidulés en forme d'ostie, de la croquande, des sucres d'orge et des cacahouettes qu'elle faisait griller chez le boulanger M. Deveze, 33 rue de Lorraine.

Plus bas, en face du portail des jacobins, qui n'a pas connu les bonbons de M. Coma puis de son beau-fils, M. Perez? Monsieur Pérez, ici avec son épouse faisaient aussi des crêpes et de la croquande (nougat caramélisé rougeâtre) pour les foires de la Sainte-Catherine (novembre) ou des comportes (mars). Avec son camion, on retrouvait aussi M. Perez pour les fêtes de la cité sur le jardin du Prado près de la porte narbonnaise. A sa suite, c'est leur employé depuis 23 ans, madame Quirant qui a repris l'affaire.

Madame Quirant et sa fille Nicole, ont installé leur camion plus haut en tournant le dos à la caserne Laperrine. Elles ont étoffé leur stock en vendant des frites, Hot-dog, sandwiches Américains... La plus grande partie de leurs clients étaient les militaires du 3e RPIMA. Ils laissaient leurs listes et venaient ensuite se ravitailler chez madame Quirant. Une affaire florissante à cette époque. Puis après la guerre du Golfe, les militaires ont obtenu le droit d'avoir un appartement en ville. L'arrivée des fast-food et des pizzerias à Carcassonne au début des années 1990, a sérieusement fait chuter le chiffre d'affaire de ce commerce ambulant. La construction du parking souterrain a achevé tout espoir de reprise. On a d'abord voulu exclure ce commerce de son emplacement, puis on l'a mis dans une guérite dont l'exiguité ne permettait pas la poursuite de l'activité. Madame Quirant a jeté l'éponge et ainsi disparut le dernier et emblèmatique marchand de bonbons de Carcassonne.

______________________________
© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2013