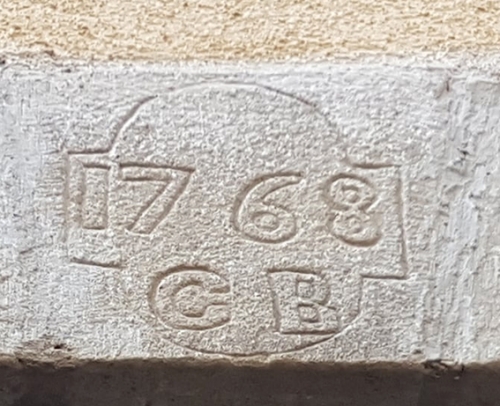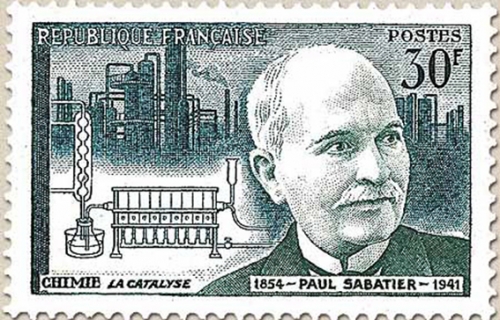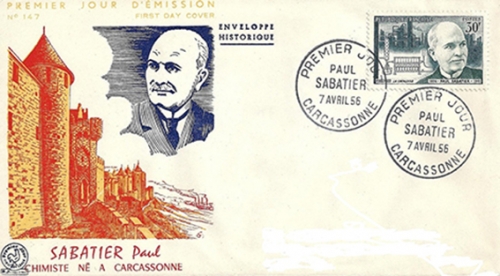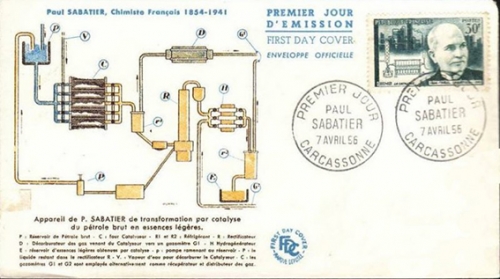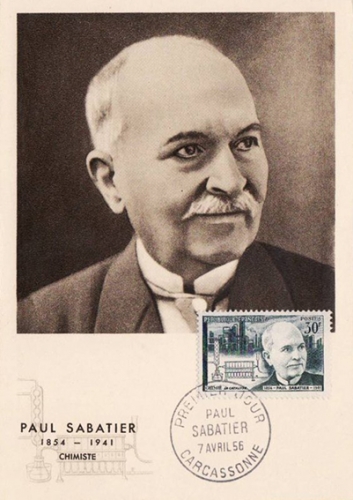Les époux Vinsani menaient une existence ordinaire et discrète à Carcassonne pendant l’Occupation. Ni la Milice française, ni la police allemande n’étaient au courant que le mari avait durant la guerre civile espagnole, soigné des Républicains et partageait des idées communistes. Ce couple aurait bien pu ne pas être inquiété s’il n’avait pas été dénoncé par Madame Marguerite S, habitant rue Laraignon et serveuse de son état ; la voisine d’à côté, qui ayant la cuisse légère s’amusait à recevoir des soldats allemands chez elle. Madame Vinsani excédée par le vacarme quasi quotidien engendré par ce remue-ménage, eut le malheur de se plaindre auprès de cette sans-gêne. Se sentant sans doute protégée par sa collaboration horizontale, la voisine lui répondit alors : "Et vous ? Lorsque vous faites marcher Londres jusqu’à une heure du matin… Je vous dénoncerai à la Police allemande !"

© Pinterest / Un village français
Le 4 juillet 1944 vers 19h45, deux allemands en civil se présentent au domicile des époux Vinsani alors que ceux-ci sont en train d’écouter Radio-Londres en langue italienne. Inutile de préciser qu’il était formellement déconseillé de se livrer à ce type d’activité, au risque d’être dénoncé. C’est sans aucun doute ce qu’il arriva après que la voisine eut prévenu la Gestapo. Sans aucun ménagement, les agents perquisitionnent la maison et amènent Monsieur Vinsani dans une des geôles de la caserne Lapérine. Son épouse l’accompagne, mais il lui est signifié de se rendre le lendemain dans les locaux de la Gestapo, au numéro 67 route de Toulouse.

© Pinterest / Un village français
Après avoir pris soin de faire brûler chez elle les documents qui pouvaient compromettre son mari, madame Vinsani se rend à 9 heures du matin au rendez-vous. Elle est accueillie fraîchement par deux allemands : le chef est brun, c’est Eckfellner ; l’autre est blond et lui sert d’interprète sans toutefois parler correctement le français, c’est Schiffner. On lui pose alors tout un tas de question. Elles s’enchaînent les unes après les autres sans que parfois l’on prenne même le temps de la laisser y répondre : "Où avez-vous connu votre mari ? Depuis quand êtes-vous mariée ? S’est-il rendu en Espagne ? Est-il Communiste ?" A ce flot d’interrogations, madame Vinsani répond qu’elle a connu son futur époux à Perpignan, qu’elle s’est mariée avec lui voilà cinq ans à Maureillas (Pyrénées-Orientales). Elle nie ses déplacements en Espagne et ses idées Communistes.

© Pinterest / Un village français
Préparée à l’avance, on cherche à lui faire signer une déposition rédigée en langue allemande. Elle comprend que les perquisitions chez elle n’ayant rien données, la police allemande use d’un subterfuge pour obtenir des aveux. Elle refuse donc d’apposer sa signature sur un document dont elle ne comprend pas le sens. On la fait descendre au rez-de-chaussée dans une pièce où elle reste un moment sans que l’on s’occupe d’elle. Au bout d’un instant, madame Vinsani est invitée à passer dans une autre pièce où l’attendent Schiffner et René Bach. Ce dernier, interprète Alsacien de la Gestapo de Carcassonne, lui indique qu’elle est folle et qu’on allait la faire interner à Limoux. Refusant à nouveau de signer, le tortionnaire lui dit alors : "On fera votre maman prisonnière !" Elle bondit de sa chaise : "Vous ne ferez pas une chose comme celle-là !" Eckfellner, le chef de la Gestapo, lui adresse alors un violent coup de poing dans la poitrine qui la fait asseoir sur son siège.
Vers 13 heures, nouvelle demande :
"Voulez-vous signer ?"
"Non"
"Alors vous prison."
Elle est alors conduite à la caserne Laperrine.

L'ancienne villa de la Gestapo, avenue F. Roosevelt
Le lendemain, la Gestapo ramène Philippine Vinsani dans ses locaux de la route de Toulouse pour un nouvel interrogatoire. Nouvelle insistance pour la faire signer et nouveau refus. Notons que pour si terrible que furent les autorités allemandes envers leurs prisonniers, jamais elles n’agissaient en dehors des règles du droit dictées par le Reich. Il fallait toujours des aveux signés.

La cheminée de la villa avant sa destruction en 2016
"Dans la pièce où je me trouvais, se trouvait au coin de la cheminée, un fusil mitrailleur. Le chef de la Gestapo l’a pris en main et s’est mis à parler en allemand avec Bach qui se trouvait assis à un bureau, dont il avait tiré dans le tiroir un révolver qu’il chargeait avec des balles. Toute cette mise en scène a certainement été faite pour m’intimider et me faire croire qu’ils allaient m’exécuter. Ayant eu réellement peur et pris d’envie de vomir. Bach m’a dit : "Vous n’allez pas rendre ici, allez aux WC au fond du couloir." Lorsque je revins, Bach me dit : "Vous allez rester 15 jours sans manger ici." Comme je ne voulais pas signer, il m’a dit qu’on allait contrefaire ma signature. Au bout d’un moment, le chef est revenu porteur de mon sac à main, qui m’avait été retiré au cours de mon incarcération. Bach m’a dit : "Vous êtes en liberté, gardez pour vous tout ce qui a été dit et fait ici, car vous êtes en surveillance, vous ne vous en sortirez pas comme aujourd’hui. Je suis sortie sans signer la fiche et mon mari a été libéré au bout de quinze jours."

Le couloir de la villa avant sa destruction
Les époux Vinsani ont jugé plus prudent de quitter Carcassonne et de n’y revenir qu’après la libération de la ville. Quant à leur dénonciatrice, elle a arrêtée avec sa sœur puis tondue. Elle écopa de la peine d’Indignité nationale avec confiscation de 20 % de ses biens.
Sources
Procès de René Bach / ADA 11
Jugements de la chambre civique de l'Aude
________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017