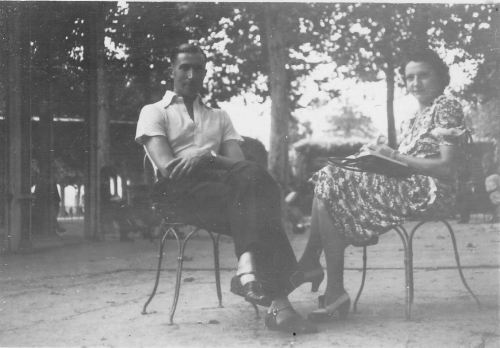Au début de l'année 1944, les Allemands craignent qu'un débarquement des alliés ne s'effectue par la côte Languedocienne. Le 12 janvier, à la Milice de Carcassonne on apprend par le chef de cabinet du préfet de l'Aude que la côte est en cours d'évacuation. Les villes de Sigean, La Palme, La Nouvelle, Leucate sont frappées par cet ordre qui sera effectif le 15 février 1944. Les généraux Allemands Blaskowitz (commandant la Première armée), Wiese (commandant la 19e armée), Rommel (commandant le groupe d'armée B) et Von Rundstedt (commandant en chef du front Ouest), inspectent cette côte.

© dday-overlord.com
Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt
La Résistance est au courant grâces aux informateurs du réseau Gallia, dirigés dans l'Aude par Maurice Jean. Le commandant des gardes-voies, Froly, fournit des fiches techniques sur les ouvrages d'art ; 400 points sensibles sont ainsi répertoriés. Maurand, un entrepreneur du sous-secteur de Leucate, se fait embaucher pour la construction de blockhaus et relève les plans des fortifications. On compte également de nombreux employés de la SNCF qui surveillent les mouvements de troupes. Emmanuel Gabarros, monteur de lignes aux PTT de Narbonne, se distingue en s'approchant assez près du logement du général commandant une division allemande récemment arrivée pour distinguer sur les chemises de l'officier ses initiales. Ceci permit l'identifier ainsi que son état-major et sa division : le général Richter.

Le château du parc à Capendu
A Capendu se trouve le Quartier Général du 4e corps d'armée allemand commandé par le général Erich Petersen (1889-1963). Il est réparti entre quatre châteaux du lieu. C'est dans l'un de ceux-là que vit la comtesse Van Wyhe, dite Camille, ancien agent de l'Intelligence Service en Hollande pendant la Grande guerre. Pour la bonne cause, la comtesse se lie avec un officier supérieur allemand auprès duquel elle soutire des informations pour le réseau Gallia.
"Chaque jour, le courrier circule entrer les quatre châteaux par les soins d'un soldat allemand. Ce soldat, un Autrichien anti-nazi, travaille pour le réseau Gallia pour qui il est Frédéric. Seuls la comtesse et Maurice Jean sont au courant de ce double-jeu. Les documents passent d'abord chez la comtesse qui les photographie avant qu'ils n'atteignent leurs destinataires. Frédéric n'accepta jamais de récompense. Il voulait seulement rentrer chez lui. Le réseau dispose également de deux informateurs allemands dans ce sous-secteur.
En 1944, un Oberleutnant, commandant un groupement de panzers de la division Das Reich, est recruté. Il est fatigué de la guerre, songe à déserter et livre ses informations sur les effectifs et les mouvements de sa division contre rétribution en dollars. En juin 1944, la "Das Reich" fait mouvement vers la Normandie, s'illustrant en chemin par les pendaisons de Tulle et le massacre d'Oradour-sur-Glane, et nul n'entend plus parler de cet officier.
Un feldwebel de la Luftwaffe surnommé Franck, qui a été en poste dans la région de Peenemüde, informe le réseau des essais de V1 peu avant que n'aient lieu les premiers tirs sur l'Angleterre. Il livre également des renseignements sur les mouvements de son unité quand elle part en opération contre les maquis, et sur une nouvelle arme antichar, le Panzerfaust.

Von Rundstedt au procès de Nuremberg
Le Géneralfeldmarschall von Rundstedt séjourne trois jours au château du parc de Capendu. La comtesse alias Camille, imagine un plan pour faire enlever le général et l'envoyer en Angleterre. Un commando de résistants viendrait, capturerait l'officier et le conduirait vers un terrain d'atterrissage. Ce projet jugé trop risqué sera refusé par le chef de région du réseau Gallia. Gerd von Rundstedt sera arrêté le 1er mai 1945 par les troupes américaines et fait prisonnier. Accusé de crimes de guerre en raison de sa participation aux assassinats de masse dans les régions soviétiques occupées, il assiste au procès de Nuremberg. En raison de sa santé chancelante et de son âge, les britanniques le libèreront en mai 1949. Il meurt le 24 février 1953 à Hanovre à l'âge de 73 ans.
Sources
Mémoire DEA Histoire du XXe siècle/ J-P Meyssonnier / IEP de Paris /1994
Antimaçonnisme, Francs-maçons et Résistance dans le midi Toulousain
Wikipédia
_______________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017