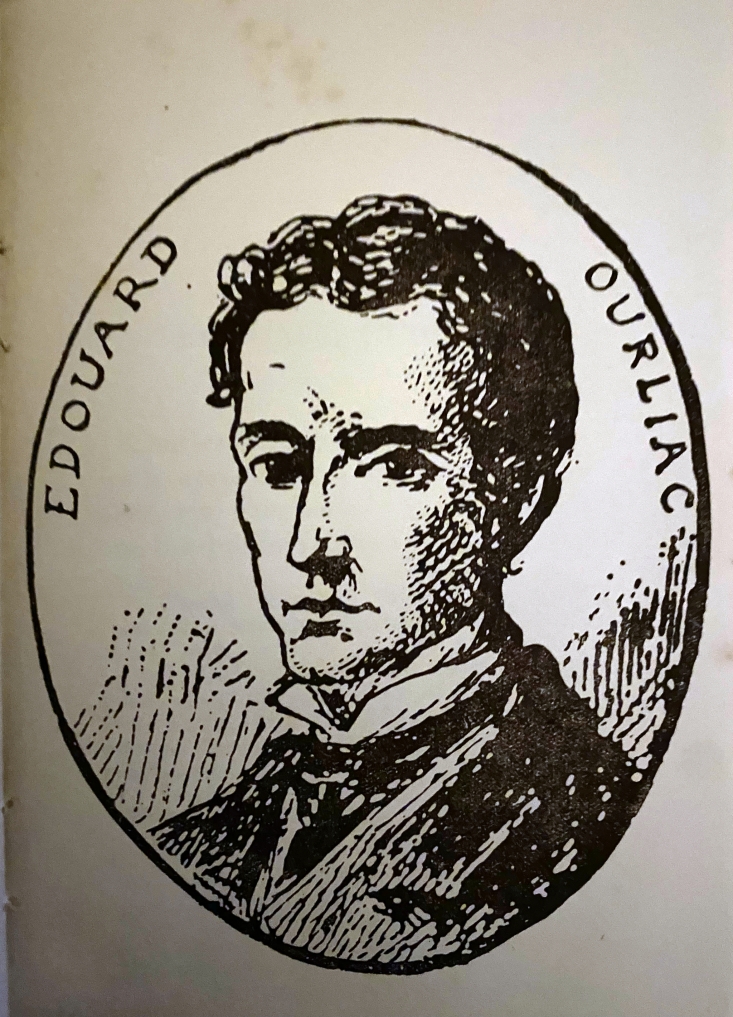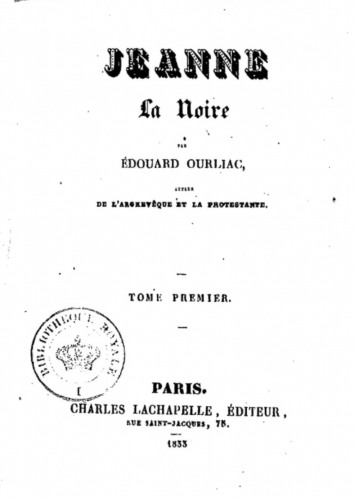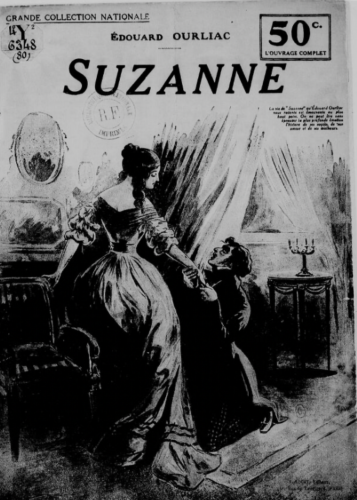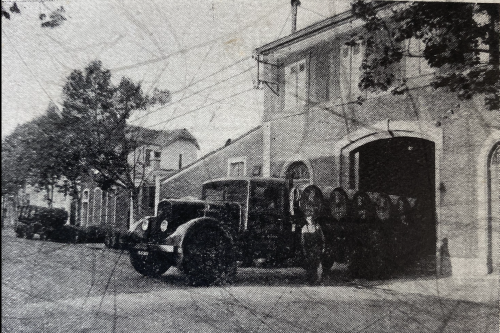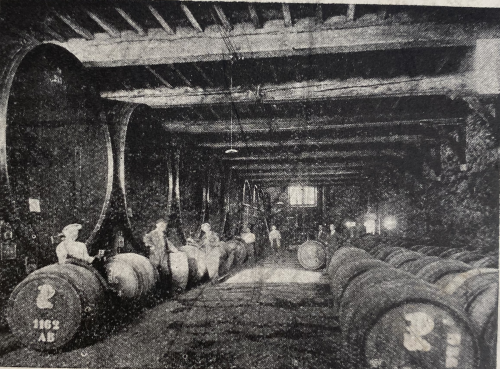Le 25 septembre 2020 la presse régionale se fit fait écho d’une extraordinaire acquisition réalisée par le musée des Augustins de Toulouse. Ce dernier venait de mettre la main sur le fragment d’un tableau vendu aux enchères aux Etats-Unis, dont tout laissait penser que le peintre pouvait être Nicolas Tournier. Après expertise, le conservateur du musée attribua la toile à ce maître du caravagisme qui s’était établi à Toulouse à partir de 1628. Il pourrait s’agit selon toute vraisemblance d’un fragment de La bataille de Constantin contre Maxence, découpée façon puzzle par des marchands et revendue sur le marché de l’art. Toujours d’après les experts, une pratique assez courante. Ce qui nous interpella, c’est l’autre hypothèse avancée par le conservateur du célèbre musée toulousain : « Il n’a pas écarté l’idée que le fragment pourrait appartenir à un autre tableau de Nicolas Tournier, Un tableau de la période toulousaine, languedocienne, éventuellement une composition mythique, « L’entrée de Louis XIII à Carcassonne » qui a été détruit et que personne n’a jamais vu. »

Le fragment acquis par les Augustins de Toulouse en 2020
À partir de cette information, nous nous sommes mis en quête de rechercher si les soupçons d’Axel Hémery pouvaient coller avec le fragment. Un tableau détruit et que personne n’a jamais vu, voilà qui ne manqua d’attiser notre curiosité… En feuilletant les délibérations du conseil général de la commune de Carcassonne pendant la période révolutionnaire, nous avons appris que ce tableau existait bien. Au moins, jusqu’au 1er février 1792. À cette date, l’assemblée municipale est saisie par l’un de ses membres « qu’un artiste, arrivé depuis quelques jours à Carcassonne, offre de réparer à bon marché le grand tableau qui se trouve dans la grande salle, représentant l’entrée de Louis treize dans Carcassonne. » De quelle grande salle s’agit-il ? Cela ne peut être que la salle des fêtes de l’ancienne maison consulaire de Carcassonne. Autrement dit, l’hôtel de ville détruit au début des années 1930 par la municipalité d’Albert Tomey. Ceci se trouve confirmé par une autre délibération du 12 décembre 1755 provenant des registres de l’Hôtel de ville, dont la copie est reproduite dans le Cartulaire de Mahul :
« A été dit que M. l’Intendant ayant bien voulu, par son ordonnance du deux septembre dernier, autoriser les sieurs Maire et Consuls à traiter avec le sieur Despaz, fameux peintre de la ville de Toulouse, pour la réparation du tableau placé à l’Hôtel de ville, représentant l’entrée de Louis XIII à Carcassonne, ce peintre se serait rendu en cette ville dans le mois de novembre dernier, pour le vérifier et reconnaître les réparations dont il était susceptible : qu’il en adresserait rapport le 9 du mois de novembre : et ce même jour il est convenu avec lui qu’il se chargerait de toutes les réparations de ce tableau détaillées dans son rapport, au moyen d’une somme de 684 livres, qui lui serait payée après que l’ouvrage aurait été reçu par MM. Pech de Saint-Pierre et Rivalz fils, habitants de ville, connaisseurs et amateurs en peinture et en sculpture, qui seraient priés par le Maire, Lieutenant de maire et Consuls, de vouloir procéder à cette réception : qu’ils ont proposé en conséquence à ces deux Messieurs de vouloir se charger de cette réception, ce qu’ils ont eu la complaisance d’accepter ; qu’en conséquence il s’agit de poursuivre l’autorisation de Mgr l’Intendant ; comme aussi il est mis en délibération si on agréerait l’offre du sieur Lacombe doreur de cette ville, de dorer le cadre dont le sieur Depaz s’est chargé d’orner le tableau, pour le prix de 288 livres, et de prendre les deux sommes sur le fonds de la subvention à la charge de la remplacer. »
Le restaurateur dont il est question n’est autre que Jean-Baptiste Despax (1710-1773), artiste peintre toulousain. Élève d’Antoine Rivalz, il avait épousé sa fille. Pierre Viguerie écrit :
« Le tout fut exécuté, puisque chacun voir encore (1789), avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction, cet immense tableau bien réparé et orné d’un cadre sculpté bien doré. Il est surprenant que le corps municipal de Carcassonne n’ait pas eu l’attention de nous laisser le nom de l’excellent artiste qui fit le tableau dont il s’agit. »
Cette question dont personne ne détient encore aujourd’hui de réponse pourrait trouver une réponse dans les archives des sieurs Despax et Rivalz, si elles sont conservées à Toulouse. En qualité de restaurateur, Despax a sûrement consigné quelque part dans son rapport le nom de l’auteur de la toile. Nous aimons à penser que la solution de l’énigme se trouverait dans quelque tiroirs de la ville rose. Jusqu’à présent, les historiens de l’art ont toujours émis l’hypothèse que Nicolas Tournier en serait le géniteur. En effet, le célèbre peintre Franc-Comtois a vécu à Carcassonne de 1622 à 1627. C’est sans doute ce qui amène le conservateur du musée des Augustins à songer que fragment puisse aussi venir du tableau Carcassonnais.
Toutefois, cette idée se retrouve battue en brèche. L’historien Jean-Bonnet prétend qu’il fut matériellement impossible à Tournier de peintre un tel tableau alors qu’il réalisa plusieurs commandes dans ce même temps. Rien ne permet d’étayer l’une et l’autre des affirmations puisque, d’après le conservateur, « L’entrée de Louis XIII dans Carcassonne » a été détruite et que personne ne l’a jamais vue. Qu’en est-il vraiment ? Pierre Viguerie (1737-1813) l’a vu. L’historien nous en donne une description précise dans son ouvrage « Annales ou histoire ecclésiastique et civile de la ville et du diocèse de Carcassonne, rédigé avant la Révolution.
« Le lieu de réception est hors de la ville, auprès de la porte dite de Toulouse : on y voit deux grands ormeaux, et sur un plateau plus élevé, deux moulins à vent, situés sur la partie des remparts qui borne la ville au sud et à l’ouest.
Au milieu du champ, Louis XIII adolescent, coiffé d’un chapeau surmonté de plumes blanches et dont une aile est abaissée, vêtu d’un pourpoint de taffetas blanc, sur le devant duquel se croisent le cordon bleu et un baudrier auquel pend l’épée renfermée dans un fourreau de couleur pourpre, s’avance vers la ville, monté sur un superbe cheval blanc, richement harnaché ; à sa droite marchent deux hérauts d’armes, revêtus de leur cotte-maille, dont la partie inférieure est chammarée de diverses couleurs disposées par bandes obliques et dans lesquelles le bleu domine : l’un tient la bride du cheval de M. De Montmorency, l’autre semble adresser la parole à un hallebardier qui est vis-à-vis de lui. Le Roi est escorté par deux hallebardiers, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, vêtus de pourpoints violets, recouverts de casaques en forme de dalmatique, de satin blanc bordées de la même couleur : ils tiennent d’une main une hallebarde appuyée sur l’épaule, de l’autre un chapeau noir orné de plumes de couleur aurore. Devant le Roi est le Duc de Montmorency, qui a mis pied à terre ; il est décoré du cordon bleu, vêtu d’un pourpoint blanc brodé en or, d’un haut-de-chausse fond noir fleuri, et tient d’une main un chapeau noir orné de plumes blanches, de l’autre il présente au Roi les quatre Consuls (qui étaient alors M. Bernard de Reich, seigneur de Pennautier, MM. Antoine Camus et jean Maffrre, bourgeois, et Jean Julia, marchand), vêtu de robes rouges, la tête découverte et à genoux (à l’exception de M. De Reich qui, en qualité de gentilhomme ou de noble n’a qu’un genoux fléchi), suivis du greffier et du Clavaire de l’Hôtel de ville, en habit noir : ils offrent au Roi un dais de brocatelle fond rouge, dont les quatre soutiens bleus sont portés par autant de valets de ville, et un huissier en robe noire. Plus loin, on aperçoit les Avocats et les Bourgeois qui ont accompagné les Consuls.
Après le Roi, marchant quatre seigneurs à cheval, décorés de cordons bleus : le premier, qui paraît âgé d’environ 70 ans, est vêtu d’un pourpoint rayé de noir et de jaune, de gauche à droite ; il porte la croix de l’ordre du Saint-Esprit attachée à deux rubans bleus réunis au-dessous de la poitrine ; près de lui marche un écuyer, vêtu d’un juste-au-corps rouge, ayant un haut-de-chausse rayé par bandes rouges et noires, tenant sous le bras un chapeau blanc qui pend avec grâce vers la terre, et de l’autre la bride d’un beau cheval alezan dont les crins blancs flottent sous l’encolure. Le troisième, âgé d’environ quarante-cinq ans, a près de lui un écuyer, vêtu d’un pourpoint fauve auquel tiennent des manches d’une étoffe de soie brochée en or, son haut-de-chausse est de couleur écarlate, il porte à la main un chapeau noir orné de plumes ponceau, et il est tourné vers le cavalier dans l’attitude de quelqu’un qui reçoit ses ordres. La quatrième figure est celle d’un homme d’environ 25 ans, magnifiquement drapé de velours vert brodé de galons d’or, doublé de velours cramoisi ; ses bottes sont de couleur violette."

Le Bastion des moulins ou de la Tour grosse
Le 14 juillet 1622, la ville basse — par opposition à la ville haute qu’est la cité médiévale — se trouvait uniquement à l’intérieur des remparts qui la ceinturaient. La porte de Toulouse, lieu de réception de Louis XIII, était située tout en haut de la rue de Verdun. On aperçoit deux moulins à vent sur la partie des remparts qui borne la ville au sud et à l’ouest. Il s’agit selon toute vraisemblance du Bastion des Moulins — aujourd’hui, Bastion du Calvaire — à l’extrémité sud-ouest des remparts de la ville basse. La Roi adolescent, ne doit pas être entendu au sens actuel. La majorité depuis Henri III avait été fixée à 25 ans pour les hommes. En 1621, le jeune Louis XIII n’avait que 21 ans. Historiquement, il est parfaitement crédible que le Roi soit positionné à la porte de Toulouse. Quelques jours avant, lui et ses troupes, avaient soumis par la force la ville protestante de Nègrepelisse près de Montauban. La totalité de la population y avait été passée par l’épée et le bourg incendié. Louis XIII que l’on représente en majesté sur ce tableau, n’avait pas des intentions pacifiques. Il venait s’assurer de la loyauté de la ville. Il y fut reçu par les Consuls dont Bernard Rech de Pennautier, le protecteur du peintre Nicolas Tournier qui réalisa son portrait. C’est sans doute ce qui laissa supposer que l’artiste fût l’auteur de la toile. Nous savons qu’en 1632 à Narbonne, les Consuls de la ville lui demandèrent de les représenter entourant le roi Louis XIII.

© Chateau de Pennautier / Lorgeril
Bernard Rech de Pennautier par Nicolas Tournier
Le tableau de la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Carcassonne a t-il été détruit ? Nous savons qu’en 1792, il s’y trouvait encore et qu’une restauration était en projet. Dans la délibération communale du 6 février 1794, on apprend la chose suivante :
« Qu’il sera placé sur la cheminée de la grande salle de la maison commune un tableau représentant la République sur un piédestal sur lequel seront inscrits ces mots : « Acte constitutionnel et le 1er article des Droits de l’homme. Le Conseil général charge le citoyen Germain de faire ce tableau et l’autorise à y ajouter tels arguments que le génie de son art lui inspirera. »
Qui était donc ce Germain ? Selon nos recherches, il pourrait bien s’agir de Bernard Germain (1756-1845), le grand oncle du compositeur Chaurien Pierre Germain. Bernard Germain avait pour ami le peintre Jacques Gamelin, qui lui confia plus tard de le seconder dans sa classe de dessin au collège de la ville. Germain savait donc peindre et sa relation avec Gamelin a une importance pour ce qui va suivre. On peut légitimement considérer que le tableau royal ne se trouvait plus en 1794 sur la grande cheminée de la salle des fêtes. Où était-il donc passé ? Dans une autre délibération en date du 10 août 1793, il est dit :
« Jour de la Fédération, il fut dressé un échafaudage pour brûler tous les monuments, bannières, drapeaux portant quelque marque de la royauté, ainsi que les titres de féodalité. » Sur la table des matières, on trouve cette phrase : « Brûlement des tableaux de la royauté. »
Difficile d’envisager que la toile ait pu échapper à la tourmente de la terreur révolutionnaire. S’il restait une chance qu’il ait pu triompher de l’autodafé, elle s’évanouit à la lecture de Mahul dans son Cartulaire :
« Le tableau de l’entrée de Louis XIII dans Carcassonne a été brûlé en 1793, avec divers titres et papiers des Archives de l’Hôtel de ville, réputés monuments et souvenirs de la monarchie et de la féodalité. Cet acte de vandalisme fut exécuté sur l’emplacement, de forme irrégulière, situé en face de la Porte des Jacobins, entre le flanc nord de l’édifice des casernes et l’entrée du faubourg de Laraignon. »
Autrement dit, sur l’actuelle place du général de Gaulle. Cette destruction précéda celle des archives de la Cité médiévale, au mois de novembre 1793.
Revenons à Jacques Gamelin et à son ami Bernard Germain… Mahul précise qu’il est de tradition que le peintre Gamelin, sous un prétexte accommodé à la folie de l’époque, obtint de décoller, au couteau, les têtes des personnages du tableau, qu’il aurait sauvé de la destruction, et à l’aide desquelles il aurait exécuté, de souvenir, une esquisse de l’entier tableau. On ignore ce que seraient devenues ces précieuses reliques historiques.
Faut-il donc conclure que le fragment récemment acquis par le musée des Augustins, pourrait provenir du découpage de notre toile, effectué par Gamelin en 1793 ? Notre réponse est formelle. C’est non. Pierre Viguerie termine sa description de « L’entrée de Louis XIII dans Carcassonne » par cette phrase : « Il faut remarquer que toutes les figures du tableau, excepté celle du Roi, ont la tête découverte. » Si l’on s’attarde sur le fragment, l’évidence nous saute aux yeux. Plusieurs hommes sont coiffés de chapeaux et de casques. Il ne peut donc s’agir de notre tableau royal. Il ne reste plus qu’à espérer, qu’une esquisse de Gamelin veuille bien se signaler comme étant la copie du tableau brûlé le 10 août 1793 à Carcassonne.
________________________________
© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2023