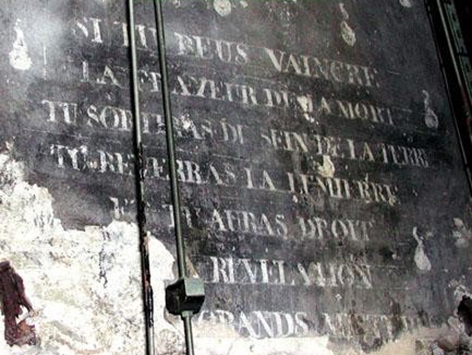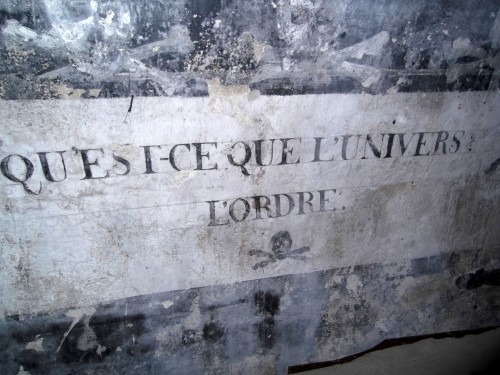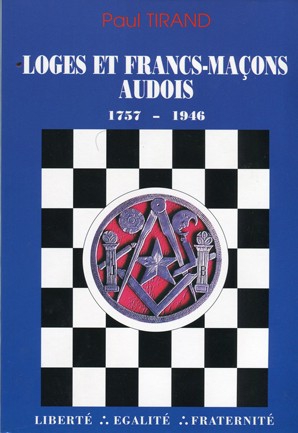Pendant plusieurs mois j'ai tenté d'interroger les anciens Carcassonnais dont les souvenirs, encore bien vivants dans leur mémoire, permettent de connaître une autre facette de la vie ordinaire pendant l'occupation que celle des archives. Il était à mon avis intéressant d'entendre ces gens à travers leurs anecdotes.
Le couvre feu
Claude Alay et André Malacan, âgés à peine de 16 ans, étaient sortis pendant le couvre-feu lorsqu’ils furent arrêtés à l’entrée de la Cité par une patrouille allemande. Halt ! leur intima un de ces vieux gradés de la Wehrmacht chargés de veiller sur l’antique monument transformé en Quartier général. Que faites-vous dehors pendant le couvre-feu ? Terroristes ?… répliqua le militaire en élevant la voix d’un façon inquiétante laissant peu de place à la négociation. Sans se démonter et le plus naturellement du monde, Claude rétorqua :
- Nous faisions une promenade digestive.
- Papiers, Papiers, bitte ! leur intima l'officier vert-de-gris
Si André Malacan put justifier sans crainte son identité, en revanche Claude Alay tira de sa poche le seul document qu’il avait en sa possession. C’est-à-dire une carte de séjour de ressortissant Espagnol.
- Vous, désignant le jeune imprudent, pas français. Étranger ! Terroriste ! Grave, très grave. Aller avec moi Kommandantur et partir en Allemagne.
Claude expliqua alors que sa mère avait fait une demande de naturalisation qui était en attente de décision. Après bien des explications, l’allemand décida de les laisser partir :
- Fichez le camp et que je ne vous revois plus.
Selon Claude Alay, ils ont eu de la chance de tomber sur un viel allemand qui devait lui aussi avoir des enfants. Ils en ont été quitte pour une belle peur ; l’affaire aurait très bien pu mal tourner.
Jeux dangereux
Georges Savi, André Malacan, Jean Jordy et Claude Alay avaient été suffisamment bricoleurs pour confectionner à partir d’un vieux poste à galène, un émetteur. Placé et caché dans le grenier de l’un des amis habitant rue de la digue, ils s’étaient mis dans l’idée par amusement, de faire fonctionner cet appareil illicite :
"L’Allemagne a perdu la guerre. Hitler est un salaud."
À plusieurs reprises ce message passa sur les ondes radio, jusqu’au jour où ils furent avertis in-extremis qu’un véhicule militaire équipé d’un radar mobile cherchait à intercepter l’émission du poste radio. Il fut aussitôt camouflé et entièrement démantelé. Les apprentis résistants venait d’échapper au pire…
Un peu trop près...
Un jour que je jouais dans la rue, mon père me surpris dans les bras d'un soldat allemand qui sûrement s'était pris de tendresse pour moi. j'avais six ans à peu près... Il devait avoir, je le suppose, lui aussi un enfant qui l'attendait en Allemagne. Après qu'il m'a reposé, mon père, de la peur me flanqua une paire de gifle dont je me suis longtemps souvenu.
Les tickets de rationnement
Nous étions quatre enfants et ma mère était veuve pendant la guerre. Aussi, avions-nous droit à des tickets rationnés en fonction de notre âge : J1, J2 ou J3. Chaque jour mon petit frère de 13 ans allait chercher le pain en rusant la boulangère, qui n'était pas dupe. Il faisait parfois la comédie en pleurant : Ma mère m'avait donné des tickets et je les ai perdus... Ainsi revenait-il quelque fois avec le pain et sans avoir dépensé les tickets. A la maison, j'étais passée experte pour couper des tranches si fines qu'on y voyait la Cité à travers. Tellement nous avions faim, du bout des doigts nous ramassions les miettes sur la table, tels des moineaux. Je ne comprends pas les gens qui aujourd'hui, mettent du pain à la poubelle.
Ma mère essayait d'accommoder les plats. Nous mangions les cosses de fèves et de petit-pois... Je sais qu'il n'y avait plus aucun rat dans la rue pendant la guerre... Les chats étaient rares. Heureusement, ma soeur travaillait à la Croix-rouge ; grâce à elle, le quotidien était un peu meilleur. La faim quand on est adolescent et en pleine croissance c'est terrible.
Les bretzels
J'apprenais le métier de boulanger chez un artisan, rue Barbès. Malgré qu'ils étaient du côté des bôches, voici comment la patronne m'a sauvée la vie. Hiver comme été j'allais travailler avec un grand manteau dont j'avais décousu la poche intérieur. Ceci me permettait d'y faire tomber des bretzels que je dérobais pour nourrir ma famille. Nous avions tellement faim ; les patrons étant collabos, je n'avais aucun scrupule. Un jour le fils me surpris ; mon manteau était si lourd qu'il était devenu suspect. Il y avait dans la boutique ce jour-là des soldats allemands venant se ravitailler. Le patron fit un scandale devant eux : "Regardez comme il me vole, ce vaurien..." Les allemands qui n'étaient pas prêts à rigoler m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer en Allemagne. Je n'ai dû mon secours qu'à la patronne qui ayant besoin de moi, les détourna de leur entreprise. Et sûrement aussi au fait qu'ils faisaient des affaires avec la kommandantur.
Place Carnot
Les jours de marché tout était réglementé. Pas question d'accéder à la place librement ; les clients devaient se tenir autour et entendre le coup de sifflet de d'un agent de police pas très commode. À une heure bien précise était donné le signal et gare à celui qui tentait de se faufiler.
Le faux résistant
À la Libération de Carcassonne, le 20 août 1944, des coups de feu retentirent dans le centre-ville. Claude Alay qui venait de se faire opérer des végétations, portait un large turban autour de la tête. Il se cacha sous une charrette à proximité de l’ancienne mairie, dans l’actuelle rue Aimé Ramond. Lorsqu’il en sortit, des Carcassonnais le prirent pour un résistant blessé durant les combats contre l’occupant en fuite. Il eut du mal à expliquer le contraire à la foule béate d’admiration pour ce si jeune patriote.
Un quartier épargné
Nous sommes le jour du départ de l'armée allemande de Carcassonne, quand devant la clinique Delteil, deux soldats qui avaient posé leurs bicyclettes se les sont fait voler. Ceci explique qu'aussitôt, la rue de la digue soit gardée à ses extrémités par des soldats en armes. Ils descendent des deux côtés et soulèvent les stores des fenêtres avec leurs mitraillettes. C'est sûr, si un civil sort de chez lui ou passe dans la rue ils vont le descendre. À ce moment-là, une personne va sauver le quartier. Il s'agit de madame Colomine. Elle ouvre sa porte aux soldats et les fait entrer chez elle, où ils prendront le café. Ainsi l'affaire se tassera sans sang versé, mais après la guerre on accusera cette femme d'avoir fricoté avec les bôches.
Quai Riquet
Un dimanche du 20 août 1944 mon père ayant été réquisitionné comme chauffeur pour transporter les troupes allemandes, ma mère se rendit chez mes grands parents à Grazailles "villa Beaumont".
Après le déjeuner mon grand-père m'amena faire une partie de pèche au bord du canal (face à la route minervoise) à hauteur de l'épicerie 'l'Etoile du Midi' - ce qu'il ne faisait jamais. Habituellement, nous allions au fresquel (pont troué).
Aux environs de 15 heures il y avait beaucoup de mouvements sur la route minervoise et nous entendions des tirs de fusils.
Mon grand père me mit à l'abri sous une pierre servant d'accès à des jardins derrière nous, nous étions trés protégés.
Au bout de longues minutes et n'entendant plus tirer, mon grand père sortit de notre abri. Il fut mis en joue par un allemand qui était en poste derrière ces blocs de pierre qui bordaient le canal (toujours présents actuellement).
Par réflexe mon grand père prit sa casquette et la brandit à l'adresse du soldat. Celui-ci lui intima de la main de se cacher à nouveau.
Aprés de longues minutes mon grand père entendant la sirène de la Croix rouge, me dit : "il faut sortir" . nous ramassons à la hâte notre attirail de pèche et nous sommes remontés à hauteur de l'épicerie. Là, j'ai pu observer un homme criblé de balles, qui s'était adossé au gros platane face à l'Etoile du Midi. Plus loin, deux autres gisaient à terre. La Croix rouge intervenant se mit à relever les morts et nous recommanda de se mettre à l'abri. Ce que nous fîmes en nous glissant derrière les bâtiments qui longeaient l'épicerie et qui brûlaient.
Là, au bout d'un long moment mon grand père me dit:" tu vas entendre dans un moment le toit qui va s'éffondrer, ce qui arriva dans un fracas.
Entendant à nouveau la Croix rouge, mon grand père me dit:" il faut sortir". Là encore un cadavre qui était relevé... nous ne nous sommes pas attardés, nous sommes repassés devant l'épicerie et pris le tournant pour remonter sur Grazailles. Nous ne risquions plus rien!
Les fusillés
J'avais sept ans quand mon père me fit monter par une échelle posée contre le mur de la caserne Laperrine, rue basse. Nous n'étions pas les seuls ; il y avait tout Carcassonne. Les miliciens condamnés descendirent en camion depuis le boulevard Barbès. Des cercueils étaient soigneusement alignés. Chacun son tour, firent le même chemin... Confession à l'abbé Pierre-Pont, mise en joue devant le mur du manège de la caserne, les balles crépitent et le condamné tombe, il est déposé dans le cercueil après le coup de grâce. Au suivant... Cette scène a hanté toute mon existence et j'en ai voulu à mon père, car ce n'était pas un spectacle pour un enfant de cet âge.
Le procès Bach
J'habitais dans la rue des chalets en 1945, au moment du procès de l'agent de la Gestapo Bach. Ma mère me dit alors cette phrase :
"Si tu n'est pas sage, tu n'iras pas au procès"
Voilà qui doit bien résumer l'humeur du moment...
Si vous avez également des témoignages de vos familles, laissez-les dans les commentaires de cet article.
_________________________
© Tous droits réservés/ Musique et patrimoine/ 2015